Bonjour à toutes et à tous, Eat's Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
Les Échos, Vin : jusqu'où ira la baisse de la consommation mondiale ?, 16/04/2025
Le Figaro, Couleur rose bonbon, hybride aux fruits, ersatz sans cacao... Quel sera le goût du chocolat de demain ?, 19/04/2025
New York Times, Meat Is Back, on Plates and in Politics, 18/04/2025
Eat’s Business fait une petite pause le week-end prochain. On se retrouve dans quinze jours.
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
Le Monde, « Il faut aller plus loin pour limiter l’accès et l’exposition aux aliments gras, sucrés, salés et ultratransformés », 14/04/2025
Une tribune dans laquelle des spécialistes de la nutrition alertent sur l’urgence d’agir face aux ravages causés par les aliments gras, sucrés, salés et ultratransformés. Ces produits, souvent bon marché et omniprésents dans l’environnement alimentaire, sont fortement liés à l’explosion des maladies chroniques comme l’obésité, les maladies cardiovasculaires, les cancers, ou encore les troubles inflammatoires. Selon les auteurs, la situation est alarmante tant sur le plan sanitaire que sur le plan économique : la France dépense chaque année plus de 20 milliards d’euros pour lutter contre l’obésité, sans compter les coûts liés au diabète de type 2 ou à d’autres pathologies associées.
Les auteurs dénoncent aussi les méthodes des industriels de la junk food, comparées à celles du lobby du tabac : manipulation du discours scientifique, marketing mensonger, instrumentalisation de valeurs comme la liberté ou la tradition culinaire. Ces entreprises entretiennent un système alimentaire qui profite peu aux producteurs, mais détruit de la valeur sociale et sanitaire. L’argument de l’augmentation de l’espérance de vie est également critiqué comme trompeur, car elle ne concerne pas toutes les catégories de population.
Les propositions avancées sont claires et s’inspirent des succès passés dans la lutte contre d’autres fléaux sanitaires. Elles reposent sur une transformation structurelle de l’offre alimentaire par des politiques fiscales (taxation de la junk food, subventions sur les produits sains), des restrictions publicitaires, une régulation du marketing et du placement en magasins. Le Nutri-Score est présenté comme un outil puissant, mais sous-utilisé, qui devrait devenir obligatoire et s’étendre à l’ensemble des produits, y compris en vrac et en restauration collective.
Les experts insistent sur l’importance d’un environnement alimentaire favorable à la santé, notamment par une meilleure accessibilité aux fruits, légumes, légumineuses, poissons et fruits à coque, et une réduction de la consommation de viande, d’alcool et d’aliments transformés. Pour eux, il ne s’agit pas d’inventer de nouvelles idées, mais d’avoir le courage politique d’appliquer des solutions déjà éprouvées. Ce changement est jugé non seulement nécessaire, mais aussi largement souhaité par la population.
Libération, A Paris, les bistrotiers veillent au grain face aux coffee-shops, 12/04/2025
L’article explore l’évolution du paysage cafetier parisien, à travers le prisme d’un affrontement culturel entre les bistrots traditionnels et les coffee-shops nouvelle génération. Le quartier de Belleville illustre cette transformation : alors que les coffee-shops prolifèrent avec leur esthétique épurée, leurs lattés au lait d’avoine et leurs cartes anglicisées, des établissements comme La Cagnotte maintiennent un esprit populaire, une ambiance chaleureuse et des prix accessibles. Leur café noir à 1,10 euro, leur clientèle intergénérationnelle et leur convivialité spontanée contrastent fortement avec les codes parfois jugés aseptisés des coffee-shops.
L’article donne la parole aux partisans des deux univers. D’un côté, des habitués de bistrots dénoncent des lieux “snobs”, perçus comme réservés à une élite jeune et branchée, déconnectée du vivre-ensemble. De l’autre, des clients de coffee-shops comme Aurore Choanier revendiquent un environnement propice au télétravail, aux rencontres et à une consommation plus qualitative. Le propriétaire du coffee-shop Miliki, Eric Ndombe, insiste sur la traçabilité du produit, la torréfaction artisanale et l’accueil familial de son établissement, reflet d’une nouvelle génération d’entrepreneurs investis.
L’article met également en lumière les enjeux économiques et sociaux derrière ce clivage. Les cafés traditionnels souffrent d’un manque de formation barista, d’un café souvent de moindre qualité, et d’une concurrence qui répond à une demande mal anticipée. Pour des figures comme Alain Fontaine, président d’un syndicat de bistrotiers, la menace est sérieuse : les coffee-shops pourraient précipiter le déclin d’un modèle patrimonial. Mais certains appellent à l’adaptation plutôt qu’à l’opposition frontale : intégrer des déclinaisons modernes du café sans renier l’âme du bistrot.
Les experts interrogés pointent un phénomène mondial, mais particulièrement tendu en France en raison du rapport culturel complexe au café et à la mondialisation. L’exemple de Berlin ou de Prague montre qu’un métissage des modèles est possible. En France, la transition reste freinée par les coûts (machines, formation) et une certaine résistance au changement. En toile de fond, ce débat révèle une fracture générationnelle et sociétale plus large autour du goût, des pratiques de consommation, et des valeurs de convivialité.
Les Échos, Vin : jusqu'où ira la baisse de la consommation mondiale ?, 16/04/2025
L’article dresse un constat alarmant sur la consommation mondiale de vin, qui en 2024 a chuté à son plus bas niveau depuis 1961. Selon l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), la consommation globale est tombée à 214,2 millions d’hectolitres, soit une baisse de 3,3 % par rapport à 2023. Cette tendance, amorcée depuis 2018, reflète des mutations profondes du comportement des consommateurs, accentuées par la conjoncture économique mondiale.
Parmi les facteurs identifiés, on retrouve une inflation généralisée qui a entraîné une hausse de 30 % du prix moyen du vin par rapport à la période 2019-2020. Les consommateurs, notamment dans les pays historiquement amateurs comme la France, réduisent leurs achats. La consommation française a ainsi reculé de 3,6 % en 2024. En Europe, qui représente près de la moitié des ventes mondiales, seule la péninsule Ibérique (Espagne, Portugal) résiste légèrement à la baisse. Les États-Unis, premier marché mondial, enregistrent une chute de 5,8 %, tandis que la Chine, après un rebond post-Covid, replonge également.
La tendance est également générationnelle. Le vin n’a plus le même attrait auprès des jeunes consommateurs, qui préfèrent réserver sa consommation à des occasions festives. On boit moins, mais mieux, selon les professionnels du secteur, qui notent une montée en gamme. Toutefois, cette valorisation ne compense pas la perte de volumes, ni les inquiétudes face à de potentielles hausses de droits de douane, notamment en cas de retour de mesures protectionnistes aux États-Unis.
Côté production, 2024 a été marquée par une récolte historiquement faible : 225,8 millions d’hectolitres, soit une baisse de 4,8 %. Il s’agit du plus faible niveau depuis plus de soixante ans. L’Europe, en tête avec 61 % de la production mondiale, a connu des conditions climatiques extrêmes, entre pluies abondantes et sécheresses. La France, avec une production en recul de 23 %, descend à son plus bas niveau depuis 1957. Seule l’Italie conserve sa première place mondiale avec 44 millions d’hectolitres.
Malgré la baisse des volumes, les exportations mondiales ont atteint 35,9 milliards d’euros, grâce à un prix au litre maintenu à un niveau record (3,60 €). Cette dynamique en valeur ne suffit toutefois pas à rassurer une filière confrontée à des défis structurels : évolution des goûts, vieillissement du public, aléas climatiques et tensions commerciales. Le secteur viticole doit se réinventer pour retrouver un équilibre entre tradition, qualité et nouvelles attentes des consommateurs.
L’Informé, Accusé d’avoir vendu du faux miel, le fabricant de Lune de Miel jette l’éponge, 14/04/2025
L’article revient sur une affaire judiciaire majeure dans le secteur du miel en France, impliquant Famille Michaud Apiculteurs, le fabricant de la marque emblématique Lune de Miel. Accusée d’avoir importé et vendu du faux miel chinois, l’entreprise a mis fin à un long bras de fer judiciaire avec la douane française en acceptant un redressement de plus de 47 000 euros. Cette décision marque la fin d’un contentieux entamé en 2014, lorsque les services douaniers avaient saisi 26 échantillons suspects, dont 24 s’étaient révélés adultérés — c’est-à-dire modifiés par l’ajout de sirops bon marché à base de riz, blé ou betterave.
Famille Michaud a longtemps contesté les analyses basées sur la résonance magnétique nucléaire (RMN), arguant que cette méthode n’était ni accréditée ni fiable à l’époque. Pourtant, l’entreprise utilisait déjà cette technologie pour des produits destinés aux supermarchés Leclerc. Après plusieurs rebondissements judiciaires — condamnation en première instance, victoire en appel, puis cassation —, l’entreprise a finalement renoncé à poursuivre la procédure. Officiellement, elle souhaite se « concentrer sur l’avenir », tout en continuant à clamer la conformité de ses produits.
Ce scandale intervient dans un contexte de défiance croissante vis-à-vis des miels importés. Les apiculteurs français dénoncent une concurrence déloyale alimentée par des produits vendus à des prix cassés, souvent suspects. Henri Clément, porte-parole de l’UNAF (Union nationale de l’apiculture française), souligne que ces importations tirent les prix vers le bas et alimentent le doute chez les consommateurs. Le jugement apporte une preuve édifiante : les lots frauduleux avaient été achetés à 1,73 dollar/kg, contre 3,65 dollars pour ceux jugés conformes, alors que le miel français standard se négocie aujourd’hui entre 4,50 et 5,50 euros/kg.
Malgré les déclarations rassurantes de l’entreprise, cette affaire ternit durablement son image auprès des apiculteurs et du grand public. Elle relance aussi la question de la fiabilité des contrôles et de l’harmonisation des méthodes d’analyse en Europe. Les fraudes sur le miel sont en effet récurrentes : une enquête de la Commission européenne en 2023 révélait que 74 % des lots importés de Chine étaient potentiellement frauduleux. Ce cas illustre la vulnérabilité de la filière face aux dérives commerciales, et souligne l’importance de garantir la transparence et la traçabilité dans l’approvisionnement.
Process Alimentaire, L’Association des Entreprises des Glaces insiste pour désaisonnaliser la consommation de glaces, 15/04/2025
L’Association des Entreprises des Glaces (AEG), qui regroupe sept poids lourds du secteur comme Unilever, Thiriet, ou Froneri, dresse un bilan mitigé pour l’année 2024, tout en affichant des ambitions claires pour 2025 : briser la saisonnalité de la consommation de glaces. Malgré une météo défavorable durant l’été — avec un mois de juin et juillet responsables à eux seuls de 71 % des pertes de ventes — le marché a su faire preuve de résilience. En volume, les ventes sont quasi stables (+0,3 %), et atteignent 1,48 milliard d’euros de chiffre d’affaires (-4,7 % par rapport à 2023).
En dépit de ces conditions difficiles, la glace reste un produit « plaisir » consommé par près de 85 % des foyers français, avec 60 000 nouveaux acheteurs conquis en 2024. Le e-commerce tire particulièrement son épingle du jeu, avec une croissance de +8,3 % du chiffre d’affaires et 9 % de part de marché. Les circuits traditionnels — supermarchés, hypermarchés — demeurent toutefois dominants, représentant 68 % des ventes.
Côté produits, les bâtonnets, cônes et bacs restent les formats préférés, mais le format pot connaît une dynamique intéressante, avec un recrutement de 900 000 nouveaux consommateurs. Cette évolution s’explique notamment par une montée en gamme de l’offre (premiumisation), et l’attrait pour des portions plus individuelles, idéales en consommation hors saison.
L’innovation est au cœur de la stratégie des industriels pour soutenir cette croissance hors période estivale. En 2024, 7,1 % du chiffre d’affaires du secteur provenait de l’innovation, une progression marquée par rapport à 2023 (2,5 %). Pour 2025, pas moins de 67 nouveautés sont annoncées. L’objectif est clair : rendre la glace attractive toute l’année. Les bons résultats des mois de mars et novembre (+10,8 % et +12,6 % en volume) montrent que la demande existe.
L’AEG plaide ainsi pour une meilleure visibilité des glaces en magasin pendant les mois d’octobre à mars. Elle appelle les distributeurs à soutenir cette stratégie en maintenant les linéaires garnis hors saison, en pariant sur des produits adaptés : formats individuels, recettes réconfortantes, glaces premium. Avec un bon démarrage en janvier-février 2025 (+9 % par rapport à l’année précédente), les industriels sont convaincus que la glace peut devenir un plaisir annuel, et non plus uniquement un produit d’été.
Le Monde, Les « bars » à concepts envahissent le marché de la restauration, 14/04/2025
L’article s’intéresse à l’essor des « bars à concepts », ces établissements de restauration ultra spécialisés qui misent sur un produit unique décliné à l’extrême, souvent dans un cadre branché et marketing-savvy. Le cas emblématique est celui d’Amone, ouvert à Paris en 2022 par Guillaume Verlet, qui propose uniquement du cordon-bleu revisité sous forme de finger food. En deux ans, le chiffre d’affaires est grimpé de 280 000 à 415 000 euros et deux franchises sont sur le point d’ouvrir.
Derrière cette tendance se cache un modèle économique agile. Les coûts d’entrée sont limités comparés à un restaurant traditionnel : peu de recettes à gérer, moins de fournisseurs, formation simplifiée pour le personnel. De plus, le temps gagné en cuisine peut être réinvesti dans le marketing, devenu un levier central du succès. Margaux Aycard, fondatrice du Bar à Brioches, l’a bien compris : elle a fait appel à une attachée de presse pour orchestrer sa présence sur les réseaux sociaux. Un passage dans une vidéo virale du média “Le Guide ultime” lui a apporté une visibilité massive.
Toutefois, cette frénésie n’est pas sans risque. Le phénomène est par nature instable : à la mode aujourd’hui, oublié demain. Le cas de Flakes, bar à céréales ouvert en 2016 à Paris, est cité comme contre-exemple : initialement boosté par les réseaux sociaux, il ferme ses portes moins d’un an après. Le danger réside dans l’essoufflement rapide de la curiosité des consommateurs, surtout quand l’offre manque de profondeur ou paraît surfacturée (comme des coquillettes à 10,90 €).
Des experts du secteur, comme Vincent Sitz ou Nathalie Louisgrand, appellent donc à la prudence : la durabilité de ces concepts dépend de leur capacité à dépasser l’effet de nouveauté. Le défi est de bâtir une marque forte, capable de fidéliser au-delà de l’effet de mode. Certains concepts réussissent leur virage, comme Coquillettes, reconverti en dark kitchen, adaptée aux habitudes actuelles de consommation via livraison.
LSA, Success story : comment Le Saint est devenu un acteur incontournable des produits frais, 16/04/2025
L’article retrace l’ascension du groupe Le Saint, entreprise familiale bretonne devenue en plus de soixante ans un acteur national majeur dans la distribution de produits frais. Fondée à Brest dans les années 1950 par Louis et Yvonne Le Saint, la société débute comme simple revendeur de fruits et légumes avant de saisir l’opportunité de la grande distribution naissante. En 1968, elle devient fournisseur du premier hypermarché Leclerc de Brest, un tournant qui marque le début de son expansion.
Sous l’impulsion des fils Denis et Gérard Le Saint, l’entreprise change d’échelle à partir des années 1990. En 1998, ils prennent les rênes et entament une stratégie de croissance externe ambitieuse. Dix-sept acquisitions ont été réalisées à ce jour, permettant au groupe de sortir de son ancrage régional breton pour s’imposer sur tout le territoire national. La dernière en date, l’entreprise Estivin à Tours (75 millions d’euros de chiffre d’affaires), illustre cette stratégie d’expansion ciblée et continue.
Aujourd’hui, le groupe emploie 2 800 salariés répartis dans 40 entités appelées “cousins”, et a atteint un chiffre d’affaires de 877 millions d’euros en 2024, dont 582 millions issus des fruits et légumes. Le reste provient de la marée (170 millions) et d’autres produits frais (122 millions), secteurs que Le Saint a intégrés progressivement, notamment via le lancement de Top Océan pour la marée et divers rachats d’entreprises spécialisées dans la viande, les produits laitiers ou encore les fleurs.
Fidèle à ses racines territoriales, l’entreprise défend le “jeu local” : soutenir les producteurs de proximité via des contrats longue durée. Elle a ainsi mis en place dès 2011 la démarche “Jouons local !” pour structurer ses engagements. Ce modèle est renforcé par une forte implication dans le tissu social local : sponsoring sportif (Stade brestois, Brest Bretagne Handball), soutien aux personnes en situation de handicap via le Fonds Le Saint.
Le groupe illustre une croissance pensée sur le long terme, alliant savoir-faire logistique, ancrage régional fort, diversification raisonnée et engagement sociétal. Il affiche des ambitions de développement durable tout en restant fidèle à ses valeurs familiales. Une success story française qui incarne à la fois modernité, ancrage local et cohérence stratégique dans un secteur hautement concurrentiel.
Les Echos, Le pesto, l'or vert de Barilla, 16/04/2025
L’article retrace l’incroyable ascension du pesto, désormais produit-phare de Barilla, devenu en quelques années un pilier de croissance pour le géant agroalimentaire italien. Longtemps perçue comme une sauce traditionnelle italienne associée aux pâtes, cette préparation à base de basilic a largement dépassé les frontières de sa Ligurie natale. En France, les ventes ont dépassé celles enregistrées en Italie en 2024, atteignant plus de 8 millions de tonnes. Le pesto est désormais la sauce pour pâtes la plus vendue dans l’Hexagone.
Barilla, avec 48 % de parts de marché, tire pleinement profit de cette tendance. L’entreprise enregistre une croissance de 30 % sur ce segment en 2024, dans un contexte où le marché alimentaire global est plutôt en repli. Le pesto séduit un public jeune, urbain, friand de cuisine pratique, visuelle et « instagrammable ». Qu’il s’agisse d’un assaisonnement de pâtes, d’un condiment pour barbecue ou d’un ingrédient pour tartes ou sandwichs, le pesto se réinvente et s’intègre à une multitude d’usages culinaires.
La stratégie de Barilla repose sur une forte capacité d’innovation. L’entreprise propose aujourd’hui 18 recettes différentes de pesto, dont la dernière en date, au pesto mozzarella di bufala campana AOP, vise un public gourmand en quête d’authenticité et de différenciation. L’implantation du site de production à Rubbiano, près de Parme, illustre cette ambition industrielle : inaugurée en 2012, l’usine a déjà doublé ses capacités en 2018 et produit aujourd’hui 30 000 tonnes de pesto par an.
Le secret de ce succès réside aussi dans la gestion rigoureuse de la filière basilic. Les récoltes sont réalisées entre mai et septembre dans un rayon de 50 km autour de l’usine, garantissant fraîcheur et traçabilité. Barilla mise également sur un marketing offensif, des dégustations et une présence forte en grande distribution. Le pesto devient un marqueur de modernité alimentaire, s’invitant à la table des foyers européens, américains et asiatiques. L’Allemagne, la France, la Suisse et bientôt le Japon comptent parmi les marchés prioritaires.
Barilla est aujourd’hui le seul acteur de dimension internationale à maîtriser l’ensemble de la chaîne du pesto, et fait de ce produit un levier stratégique pour diversifier son portefeuille au-delà des pâtes. En dix ans, le pôle sauces du groupe a quadruplé ses ventes et représente désormais 10 % de son chiffre d’affaires global, estimé à près de 5 milliards d’euros. Le pesto n’est plus seulement une sauce : c’est un phénomène gastronomique mondial.
Le Figaro, Couleur rose bonbon, hybride aux fruits, ersatz sans cacao... Quel sera le goût du chocolat de demain ?, 19/04/2025
Face à la flambée spectaculaire des prix du cacao (+170 % en 2024) et aux défis structurels de la filière, le monde du chocolat est en pleine mutation. L’article du Figaro explore cette révolution à travers trois dynamiques majeures : la montée du chocolat de spécialité, l’innovation matière et gustative, et l’apparition d’ersatz sans cacao.
Désormais, les chocolatiers s’éloignent des assemblages standardisés au profit de crus uniques issus de terroirs identifiés, à l’image du vin. La tendance « bean-to-bar » (de la fève à la tablette) s’étend, portée par des artisans comme Nicolas Berger ou des maisons comme Plaq et Hasnaâ. Même les géants comme Valrhona ou Cacao Barry s’adaptent : Valrhona accompagne les chefs avec son service Compoz pour créer des recettes exclusives à base de cacaos d’origines variées et d’ingrédients comme le sarrasin, le piment fumé ou le lait fermenté. L’objectif : singulariser l’offre et affirmer un goût plus complexe, moins sucré, plus expressif.
Cette montée en gamme s’accompagne de profondes inquiétudes : entre l’épuisement des sols en Côte d’Ivoire et au Ghana, les maladies (comme l’œdème des pousses) et le changement climatique, la disponibilité du cacao devient instable. Cela pousse l’industrie à explorer des alternatives. La start-up allemande Planet A Foods commercialise un substitut au chocolat sans cacao, le ChoViva, à base de graines de tournesol, aux arômes recréés par fermentation. La chocolaterie alsacienne Abtey propose déjà ses premiers produits avec ce matériau innovant, promettant jusqu’à 80 % d’émissions de CO₂ en moins.
La cabosse du cacaoyer elle-même devient une source de valorisation. Le mucilage, substance blanche entourant les fèves, est exploité sous forme de concentré ou de poudre pour sucrer naturellement. D’autres usages émergent, comme la réintégration de l’enveloppe des fèves dans les ganaches ou la création de meringues végétales à partir de mucilage lyophilisé, dans une logique de « zéro déchet ».
Enfin, certains artisans comme Aurélien Rivoire inventent une chocolaterie nouvelle : réduction drastique du sucre (remplacé par du xylitol), sauces en lieu et place des ganaches, pralinés à base de marc de saké ou ananas confit pour limiter le taux de chocolat tout en enrichissant l’expérience. Plus qu’un produit, le chocolat devient une matière gastronomique à repenser intégralement, dans une logique durable, créative et raisonnée.
Food & Wine, Scientists Just Figured Out How Food Aversions Actually Form, 15/04/2025
L’article explore les mécanismes neurologiques qui rendent une expérience d’intoxication alimentaire si vivace et marquante dans notre mémoire. Bien plus qu’un simple inconfort passager, ce type de traumatisme alimentaire s’ancre profondément dans le cerveau, modifiant durablement notre rapport à certains aliments.
Le processus repose en grande partie sur ce que les chercheurs appellent le « conditionnement aversif au goût »(conditioned taste aversion). Contrairement à d’autres types d’apprentissage, il suffit d’une seule mauvaise expérience pour qu’un aliment soit associé à un fort sentiment de dégoût — parfois pour la vie. Cette réaction est une adaptation évolutive très efficace : elle permet à l’organisme d’éviter de reconsommer des substances potentiellement toxiques. Le cerveau relie l’aliment à la sensation de malaise (nausées, vomissements), même si l’intoxication est survenue plusieurs heures après l’ingestion, ce qui rend cette forme de mémoire unique.
Les neurosciences montrent que des zones spécifiques du cerveau sont mobilisées dans ce processus, notamment l’amygdale (liée à la peur et aux émotions) et l’hippocampe (impliqué dans la mémoire contextuelle). Une fois le lien établi, ces régions s’activent automatiquement à chaque fois que l’on est confronté à l’aliment incriminé — parfois même à l’odeur ou à une simple image. D’où les réactions physiques incontrôlables, comme des hauts-le-cœur ou un rejet immédiat.
Mais cette mémoire « défensive » peut aussi poser problème : il arrive que des aliments parfaitement sains soient évités à tort, simplement parce qu’ils ont été associés, consciemment ou non, à un épisode de malaise. Les chercheurs notent que certaines intoxications sont attribuées à des aliments innocents, l’organisme désignant un “coupable” par association temporelle plutôt que par logique.
L’article évoque également la difficulté à « désapprendre » cette aversion. Des thérapies d’exposition progressive peuvent parfois fonctionner, mais le mécanisme est si profond qu’il résiste souvent à la rationalisation. En revanche, il existe un phénomène inverse, appelé mémoire hédonique, qui pousse à rechercher activement des aliments associés à des sensations agréables ou des souvenirs positifs.
New York Times, Where Will We Eat When the Middle-Class Restaurant Is Gone?, 04/04/2025
L’article dresse un constat nostalgique et inquiet sur la disparition progressive des chaînes de restauration assises accessibles à la classe moyenne américaine. Jadis symbole de convivialité et de stabilité familiale – à l’image du rituel hebdomadaire d’un père et de ses enfants chez Pizza Hut – ces lieux, incarnés par des enseignes comme TGI Fridays, Red Lobster ou Applebee’s, ferment les uns après les autres, frappés par des faillites, une baisse de fréquentation, et des changements profonds d’habitudes alimentaires.
Le phénomène s’inscrit dans un contexte plus large de déclin de la classe moyenne. L’essor économique qui avait permis à ces restaurants de prospérer dans les années 1980 et 1990 a laissé place à une concentration des richesses, à la précarisation des foyers, et à une transformation radicale des pratiques de consommation : livraisons à domicile, drive, restauration rapide ou encore fast-casual, comme Chipotle ou Shake Shack, qui séduisent les jeunes générations en quête d’authenticité, de qualité et d’alignement avec leurs valeurs (produits durables, transparence, éthique).
Les chaînes traditionnelles sont perçues comme dépassées, inauthentiques et déconnectées des nouvelles aspirations culturelles. Pourtant, selon certaines études, elles restent l’un des derniers lieux de sociabilité interclasse aux États-Unis. Des chercheurs ont montré, via des données de géolocalisation et d’interactions sociales, que les restaurants comme Chili’s ou Olive Garden étaient parmi les rares endroits fréquentés à la fois par des individus issus de différentes classes sociales. Là où les bibliothèques, restaurants indépendants ou fast-foods tendent à servir des clientèles homogènes, ces chaînes jouaient un rôle d’infrastructure sociale neutre.
La montée en puissance des livraisons et des repas pris seuls – souvent dans une voiture – accentue l’isolement. Selon une enquête, ce que les Américains trouvent de plus « luxueux » dans un repas, ce n’est ni le caviar ni le steak de bœuf, mais simplement… de dîner assis dans un restaurant.
La disparition de ces lieux renforce une forme d’atomisation de la société. Si les fast-casual offrent une meilleure qualité de produit, ils ne recréent pas les conditions d’un repas partagé, d’une rencontre spontanée. Le déclin de ces restaurants n’est donc pas qu’une affaire économique, il touche aussi à la qualité du lien social. Pour les auteurs, ce glissement culturel devrait alerter autant les urbanistes que les sociologues et les politiques.
New York Times, A Scientist Is Paid to Study Maple Syrup. He’s Also Paid to Promote It., 15/04/2025
L’article enquête sur les liens ambigus entre recherche scientifique et stratégie marketing dans l’industrie du sirop d’érable. Au cœur du dossier : le chercheur Navindra Seeram, biochimiste renommé, auteur de nombreuses études vantant les vertus du sirop d’érable, mais aussi consultant régulier pour le compte de l’industrie acéricole, notamment le puissant syndicat des producteurs de sirop du Québec.
Depuis plus d’une décennie, Seeram a publié plus de trente articles scientifiques mettant en avant les bienfaits potentiels du sirop d’érable – antioxydant, anti-inflammatoire, voire préventif contre certaines maladies chroniques (diabète, Alzheimer, cancers). Ces résultats sont cependant nuancés : les études s’appuient sur des extraits concentrés en polyphénols, testés en laboratoire, mais non équivalents à la consommation réelle de sirop par le public. Malgré cela, Seeram a souvent extrapolé ses découvertes dans les médias ou lors de conférences de presse, affirmant que « ce sucre est bon pour la santé », au bénéfice des campagnes promotionnelles du secteur.
Son double rôle — scientifique et porte-parole de l’industrie — soulève des critiques. Des chercheurs de Stanford et d’autres institutions dénoncent une communication qui enjolive les résultats au point de devenir trompeuse. Si Seeram n’a jamais affirmé explicitement que le sirop guérissait des maladies, son langage flou et les messages diffusés sur les réseaux sociaux, comme « anti-cancer » ou « super aliment », alimentent une confusion sur la réalité des bénéfices.
Le financement de ses recherches — plus de 2,8 millions de dollars fournis par le gouvernement canadien et les producteurs d’érable — interroge également sur l’indépendance de ses travaux. Des mails internes révèlent sa volonté assumée de soutenir activement les intérêts de l’industrie québécoise. En parallèle, il a perçu au moins 37 000 dollars en 2023 pour des « activités de relations publiques », sans transparence suffisante sur la séparation entre science et communication.
L’article met ainsi en lumière les dérives d’un système de recherche de plus en plus dépendant de financements privés, où les lignes entre rigueur scientifique et marketing s’estompent. Le cas du sirop d’érable devient emblématique d’un phénomène plus large : la difficulté de maintenir une information nutritionnelle rigoureuse dans un contexte où les intérêts économiques pèsent de plus en plus lourd sur la production et la diffusion des savoirs.
Wall Street Journal, How Josh Became a Wine Megabrand—and Which Brand Might Be Next, 10/04/2025
L’article revient sur l’ascension fulgurante de Josh Cellars, aujourd’hui l’une des marques de vin les plus connues et les plus vendues aux États-Unis, avec plus de 7,5 millions de caisses produites par an. Créée en 2005 par Joseph Carr, un ancien cadre du monde du vin, la marque a été baptisée du surnom de son père, un modeste ouvrier amateur de bière plutôt que de grands crus. Ce nom accessible et affectif, combiné à un positionnement « vin pour tous » et à une histoire personnelle forte, a permis à Josh de s’ancrer durablement dans la culture populaire.
Lancé avec 15 000 $ de stock et un 401(k) (NDLR : un plan de retraite par capitalisation proposé par les employeurs aux États-Unis), Joseph Carr a écoulé les premières bouteilles de Josh Cabernet Sauvignon tout seul en sillonnant la côte Est dans son vieux 4x4 et en signant chaque bouteille. En 2011, la famille Deutsch, vétéran du marketing du vin (notamment avec Georges Duboeuf et Yellow Tail), repère le potentiel de la marque et prend une participation. L’année suivante, elle rachète l’intégralité des parts tout en conservant Carr comme visage public du projet. Grâce à une stratégie marketing à grande échelle et à une refonte de la vinification, la production dépasse le million de caisses en 2016.
Josh s’est depuis étendu à 23 cuvées, incluant Sauvignon Blanc, Prosecco ou encore Seaswept, un blanc estival promu par des influenceurs au style de vie côtier. Le marketing, désormais doté d’un budget à huit chiffres, alterne entre authenticité rustique (Joe en chemise à carreaux) et sophistication assumée (Joe en costume Brioni).
Le succès de Josh repose sur une équation difficilement reproductible : nom simple, récit émotionnel, rapport qualité-prix solide, et timing parfait. Pour les Deutsch, aucune autre marque n’a encore réussi à répliquer cette formule. Mais les professionnels du secteur y voient un modèle de croissance rare, capable de s’imposer dans plusieurs rayons (rouge, blanc, effervescent) et de parler à plusieurs générations.
Pour espérer créer « le prochain Josh », il faudra réunir un fondateur charismatique, une histoire personnelle sincère, une gamme cohérente et grand public, et une grande puissance de frappe marketing. En somme, un équilibre entre proximité et aspirationnel — avec, peut-être, un peu de magie en supplément.
New York Times, Meat Is Back, on Plates and in Politics, 18/04/2025
Après une période de déclin face à l’essor du végétarisme et des produits à base de plantes, la viande opère un spectaculaire retour dans les assiettes américaines et dans l’imaginaire collectif. L’article retrace cette résurgence, à la fois alimentaire, culturelle et politique. En 2024, les ventes de viande ont atteint un record historique de 104,6 milliards de dollars, et la consommation individuelle a bondi de 7 % par rapport à la période pré-Covid. Seuls 22 % des Américains affirment vouloir réduire leur consommation, le niveau le plus bas en cinq ans.
Ce retour s’inscrit dans un contexte politique polarisé. À droite, des figures conservatrices promeuvent la viande comme symbole de résistance à une alimentation perçue comme élitiste et “woke”. Le mouvement “Make America Healthy Again” érige le suif de bœuf en alternative aux huiles végétales, célébré par Robert F. Kennedy Jr. et des figures médiatiques comme Joe Rogan. À gauche, d’autres prônent une viande locale, traçable, produite de manière durable. Le résultat : une union improbable autour de la viande, traversant les clivages idéologiques.
Le regain d’intérêt pour les protéines animales s’explique aussi par des motivations nutritionnelles. Avec la montée des médicaments amaigrissants comme l’Ozempic, les Américains cherchent à préserver leur masse musculaire, et la viande est perçue comme une solution pratique et naturelle. Les jeunes générations ne sont pas en reste : les Millennials découvrent le canard en version barbecue ou carnitas, la Génération Z plébiscite le poulet, notamment dans des formats pratiques et éthiques. Le régime carnivore, qui exclut légumes et céréales, séduit une frange radicale, incarnée par des influenceurs ou des couples comme les Watson, qui ont même conçu un gâteau de mariage en viande hachée et suif fouetté.
De leur côté, les restaurants s’adaptent. Sweetgreen, temple de la salade, ajoute du steak à sa carte. Texas Roadhouse devance Olive Garden, et Fogo de Chão multiplie les ouvertures, attirant une clientèle flexitarienne en quête d’expériences protéinées. Même les chefs réputés pour leur cuisine végétale, comme Victoria Blamey ou Daniel Humm, réintègrent subtilement la viande à leurs menus. Ce retour de la viande illustre une remise en question plus large du système alimentaire américain. Pour Nicolette Hahn Niman, autrice de Defending Beef, ce n’est pas un simple effet de mode, mais une réponse à des décennies de discours culpabilisants et de transformation industrielle. La viande redevient une revendication identitaire, nutritionnelle et parfois politique.
Wall Street Journal, Americans Are Obsessed With Protein and It’s Driving Nutrition Experts Nuts, 18/04/2025
L’article analyse la véritable frénésie des consommateurs américains autour des produits enrichis en protéines, qui déborde largement le cadre des régimes sportifs pour toucher le grand public. Des œufs au petit-déjeuner aux smoothies protéinés, des glaces aux chips à base de blanc d’œuf et de bouillon d’os, le marché explose : en 2024, 97 nouveaux produits ont été lancés avec le mot “protein” dans leur nom, soit plus du double de l’année précédente.
Cette « protéinomanie » se retrouve dans des produits parfois improbables : bonbons enrichis, sodas protéinés, eaux aux fruits avec 20 g de protéines, voire du colostrum bovin (le premier lait d’une vache après vêlage) utilisé dans une nouvelle poudre star lancée par Ballerina Farm, une ferme devenue virale sur les réseaux sociaux. Résultat ? La protéine est désormais un argument de vente plus porteur que le goût ou la naturalité.
Cette obsession est renforcée par la popularité de médicaments comme l’Ozempic, utilisés pour la perte de poids, qui incitent à augmenter les apports protéiques afin de préserver la masse musculaire. TikTok, Instagram et les algorithmes font le reste : recettes hyperprotéinées, régimes carnivores, mélanges douteux comme le « protein Diet Coke », tout devient viral, jusqu’à la série The White Lotus, où un personnage devient accro aux shakes protéinés.
Mais cette vague irrite de nombreux professionnels de santé. Constance Contursi, coach sportif, dénonce des « junk foods » vendus comme sains simplement parce qu’ils contiennent des protéines ajoutées. Des experts comme Bettina Mittendorfer, professeure de nutrition à l’Université du Missouri, rappellent que la population américaine consomme déjà suffisamment de protéines — souvent plus que les recommandations — et que l’excès peut augmenter les risques cardiovasculaires.
Elle déplore le marketing à outrance : « Ce dont les Américains manquent vraiment, c’est de fibres », dit-elle, ajoutant que vendre du son d’avoine est beaucoup moins sexy que des barres au goût de marshmallow ou des chips « chicken & waffles ». En résumé, le culte de la protéine est devenu un marché à part entière, souvent au détriment de l’équilibre nutritionnel réel. Derrière cette tendance, le mirage d’un aliment “miracle” masque une industrie habile à détourner les codes de la santé pour séduire les consommateurs, quitte à brouiller les repères essentiels en matière d’alimentation.
The Guardian, TikTok trend for ‘Dubai chocolate’ causes international shortage of pistachios, 19/04/2025
L’article revient sur un phénomène viral inattendu : la montée en popularité fulgurante d’une barre chocolatée haut de gamme surnommée “Dubai chocolate”, qui a déclenché une pénurie internationale de pistaches. Ce produit, initialement commercialisé exclusivement aux Émirats arabes unis par la maison Fix, associe chocolat au lait, pâte croustillante et une crème onctueuse à la pistache.
Tout commence fin 2023 sur TikTok, où une vidéo louant le goût exceptionnel de la barre devient virale : plus de 120 millions de vues cumulées. En quelques mois, la tendance explose et provoque un effet boule de neige inattendu. L’industrie du chocolat s’emballe : des marques de luxe comme Läderach, Lindt ou Prestat lancent à leur tour des créations à la pistache pour surfer sur la vague. Mais l’offre peine à suivre une demande désormais mondiale.
Ce raz-de-marée a des conséquences directes sur l’approvisionnement en pistaches, principalement cultivées aux États-Unis et en Iran. Déjà affectée par une mauvaise récolte aux États-Unis en 2024, la filière subit une flambée des prix : le kilo de pistaches décortiquées est passé de 7,65 à 10,30 dollars, selon le courtier Giles Hacking. La récolte américaine, bien que de qualité, a été orientée vers les pistaches entières (avec coquilles), réduisant les disponibilités de grains décortiqués, essentiels à la fabrication des crèmes.
L’Iran, de son côté, a intensifié ses exportations vers les Émirats (+40 % sur six mois), accentuant les tensions sur le marché. Résultat : les fabricants de chocolat sont à court de matière première, et certaines boutiques vont jusqu’à rationner les barres en raison des ruptures d’approvisionnement.
Ce phénomène montre la puissance de TikTok dans la transformation des préférences de consommation à l’échelle mondiale. Un produit local, exclusif et ultra-ciblé peut devenir en quelques semaines une icône mondiale de la gourmandise, entraînant des conséquences économiques majeures sur des filières agricoles entières. Derrière cette anecdote sucrée, une réalité s’impose : les réseaux sociaux ne modèlent plus seulement les tendances culinaires, ils modifient aussi la logistique mondiale… et le prix des fruits secs.
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A dans 2 semaines!
O. Frey




















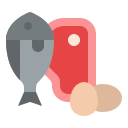

Brilliant read. Thanks for all the time and effort you out into this digest