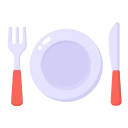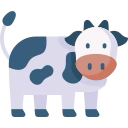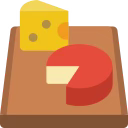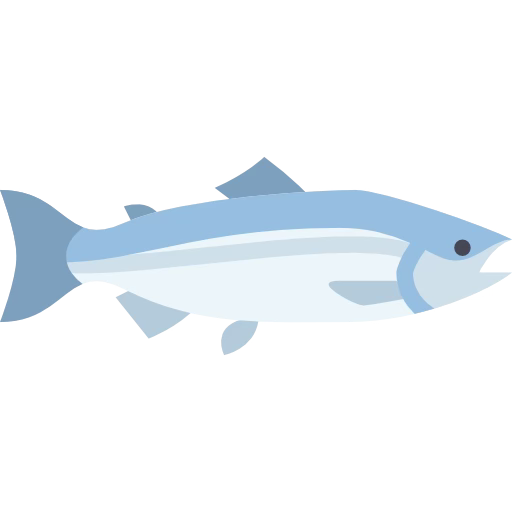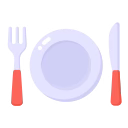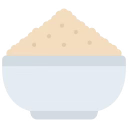🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2025-13
Bonjour à toutes et à tous, Eat's Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
Libération, Resto Reza, Reserve Go… Restaurateurs et clients alertent sur des sites de réservation en ligne douteux, 09/04/2025
Les Échos, Il est frais votre poisson maturé ?, 05/04/2025
New York Times, Is the Restaurant Good? Or Does It Just Look Good?, 09/04/2025
Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
Stéphane Brunerie, fondateur de Stripfood et expert reconnu de l’alimentaire et l’alimentation, nous a quitté il y a quelques jours. J’ai une pensée pour lui et pour ses proches avant de débuter la revue de presse de cette semaine. Il manquera par son dynamisme, sa bonne humeur et la pertinence de ses analyses.
Libération, Resto Reza, Reserve Go… Restaurateurs et clients alertent sur des sites de réservation en ligne douteux, 09/04/2025
Depuis plusieurs mois, restaurateurs et consommateurs en France dénoncent les pratiques douteuses de plateformes de réservation en ligne comme Resto Reza, Reserve Go ou Book Ici. Présentées comme des conciergeries numériques, ces plateformes prélèvent des abonnements mensuels, souvent à l’insu des utilisateurs qui pensent simplement réserver une table dans un restaurant. À travers des publicités sponsorisées bien référencées sur Google, ces sites attirent des clients qui entrent leurs coordonnées bancaires pour un “faux” dépôt de garantie, débouchant en réalité sur un abonnement mensuel de 50 euros.
Les restaurateurs sont les premières victimes collatérales de ces pratiques, recevant régulièrement des clients persuadés d’avoir une réservation… qui n’existe pas. L’incompréhension entraîne parfois des tensions, voire des pertes de clientèle. Ces services, qui prétendent gérer divers types de réservations (restaurants, taxis, coiffeurs, etc.), ne sont en réalité liés à aucun des établissements répertoriés sur leur plateforme. Plusieurs responsables de restaurants rapportent que leurs établissements y figurent sans aucun accord préalable.
Des actions en justice ont été engagées. L’avocate Marie-Hélène Fabiani a obtenu le déréférencement de restaurants haut de gamme et a alerté la DGCCRF, qui recense déjà près de 200 signalements via Signal Conso. Cependant, la législation actuelle protège mal les consommateurs qui ne lisent pas les conditions d’abonnement. Certains experts juridiques estiment que les sites restent dans la légalité tant qu’ils précisent l’existence de l’abonnement, même si cette information est peu visible.
La DGCCRF recommande aux victimes de faire opposition auprès de leur banque et de conserver les preuves pour signalement. Les restaurateurs, quant à eux, sont invités à sensibiliser leur clientèle à l’importance de réserver en direct.
Les Échos, Solinest, le petit français qui veut damer le pion à Coca et Pepsi sur les boissons prébiotiques, 09/04/2025
L’entreprise alsacienne Solinest, connue pour sa distribution de marques alimentaires comme Pringles ou Ricola, se lance dans une offensive ambitieuse sur le segment des boissons prébiotiques. Avec Yass, sa nouvelle boisson aux fibres issues de la racine de chicorée et du vinaigre de cidre, Solinest veut prendre de vitesse Coca-Cola et PepsiCo sur le marché européen, alors que celui-ci explose déjà aux États-Unis.
Déjà leader en France sur le marché du kombucha, Solinest capitalise sur cette expertise pour s’imposer sur une niche encore peu développée en Europe. Yass se positionne comme une alternative naturelle et saine aux sodas classiques : sans édulcorants ni additifs, et avec un taux de sucre réduit de 60 % par rapport aux sodas classiques. Les recettes aux goûts populaires (cola-cerise, citron vert, fruits rouges…) visent principalement les jeunes consommateurs, particulièrement sensibles aux produits bons pour la santé intestinale.
Aux États-Unis, des marques comme Olipop ou Poppi ont déjà rencontré un succès fulgurant, attirant des milliards de dollars d’investissements et suscitant l’intérêt des géants du soda. PepsiCo a récemment racheté Poppi pour 1,95 milliard de dollars. Coca-Cola s’essaie également au prébiotique avec la gamme Simply Pop. Aucune de ces marques n’est encore présente en Europe, ce qui ouvre un boulevard à Solinest pour y prendre une position dominante.
Distribuée en avant-première chez Carrefour, Yass sera progressivement étendue au reste de la grande distribution et à la restauration hors domicile dès le second semestre 2025. Fabriquée en Allemagne et en Belgique, la boisson vise plusieurs dizaines de millions d’euros de chiffre d’affaires, avec un potentiel évalué à 200 millions d’euros pour l’ensemble du marché européen.
Cette diversification s’inscrit dans une stratégie plus large de Solinest, qui cherche à développer ses marques proprespour anticiper les nouvelles attentes des consommateurs : santé, naturalité, efficacité digestive. Forte d’un chiffre d’affaires de 380 millions d’euros, l’entreprise espère ainsi bousculer les codes du marché des soft drinks, jusque-là dominé par les mastodontes américains.
Les Échos, Spiritueux : Diageo vient défier Pernod Ricard sur ses terres, 08/04/2025
Le géant britannique des spiritueux, Diageo, entend renforcer sa position sur le marché français, historiquement dominé par Pernod Ricard. Actuellement détenteur de 8,2 % de parts de marché, Diageo ambitionne d’atteindre les 12 % d’ici à 2030. Pour cela, le groupe a mis en place une stratégie offensive, en internalisant depuis janvier 2025 la gestion de ses 43 marques (dont Johnnie Walker, Cardhu, Talisker…) via une nouvelle filiale française de 90 salariés.
L’accent est mis sur le whisky, boisson pour laquelle la France est le deuxième marché mondial en volume, mais dont le potentiel reste jugé « sous-exploité » par Diageo. Le groupe mise aussi sur la tequila (Don Julio, Casamigos), les rhums, les liqueurs, ainsi que le sans-alcool, un segment en pleine expansion auprès des jeunes générations. Une nouvelle référence, Captain Morgan 0.0 %, a récemment été lancée, suivant le succès du Tanqueray 0.0 %.
Cette réorganisation vise à corriger les faiblesses constatées dans l’ancienne stratégie de distribution, notamment via Moët Hennessy, qui négligeait certains circuits comme les cavistes et la restauration hors domicile. Pour y remédier, Diageo s’appuie désormais sur des partenaires logistiques spécialisés (Maisons du Whisky, Dugas, France Boissons) afin de mieux couvrir les hôtels, bars, cavistes et GMS.
La stratégie repose aussi sur le phénomène de premiumisation : les consommateurs achètent moins en quantité, mais choisissent des produits plus chers, à condition qu’ils soient bien expliqués et mis en valeur. Diageo entend donc mieux accompagner ses produits sur le terrain avec une équipe dédiée de 42 personnes chargée de promouvoir ses marques.
Pour Patrick Gantier, directeur Europe du Sud, la France constitue un marché stratégique et singulier, notamment grâce à la culture de l’apéritif, toujours vivace. Diageo entend s’y imposer en misant sur l’innovation, la qualité, une présence accrue dans les points de vente spécialisés, et une lecture fine des nouvelles tendances de consommation, sans négliger les enjeux logistiques et marketing.
Les Échos, Elever des vaches plus petites, plus vite : le pari iconoclaste de Charal, 08/04/2025
Dans un secteur bovin français traditionnellement attaché à ses races pures, Charal, filiale du groupe Bigard, bouscule les codes en encourageant l’élevage de bovins croisés issus de vaches laitières et de taureaux de races Angus ou Hereford. L’objectif : produire des animaux plus petits, plus rapides à élever, mieux valorisables en boucherie, tout en répondant à une demande croissante pour des portions réduites et des pratiques agricoles plus durables.
Ce projet s’inscrit dans une démarche lancée dès les années 2000, face à un paradoxe : alors que les consommateurs demandent des portions plus modestes, les bovins issus des races à viande sont devenus toujours plus imposants, compliquant les conditions de travail des éleveurs. Avec l’appui de l’INRAE, Charal propose aux éleveurs de croiser leurs vaches laitières avec des races à viande adaptées à l’herbe, réduisant les coûts d’élevage, les besoins en aliments concentrés, et le temps nécessaire avant abattage.
Ce système repose sur un contrat appelé l’Herbo’Pacte, qui garantit à l’éleveur un prix d’achat supérieur (environ +25 %) et une sécurité dès l’insémination de la vache, soit trois ans avant la vente. En 2024, 651 éleveurs avaient rejoint le programme, pour un total de 4 031 bovins concernés. Bien que ce chiffre reste modeste par rapport aux quelque 30 000 éleveurs partenaires de Charal, il représente une dynamique prometteuse.
Au-delà des intérêts économiques, ce modèle vise également une valeur environnementale. Les prairies françaises, couvrant environ 45 % de la surface agricole, jouent un rôle crucial dans le stockage de carbone et la biodiversité. Sans ruminants pour les entretenir, leur avenir est compromis. Les races Angus ou Hereford, valorisant bien l’herbe, permettent de préserver ce patrimoine tout en s’affranchissant des systèmes intensifs.
L’expérience menée par l’unité expérimentale du Haras du Pin avec l’INRAE démontre la viabilité technique et agronomique du croisement entre vaches Prim’Holstein, Normandes ou Jersiaises avec des taureaux Angus. Charal espère désormais élargir son réseau d’éleveurs pour structurer une filière alternative à la viande bovine conventionnelle, plus en phase avec les enjeux contemporains de consommation, d’éthique animale et d’écologie.
Les Échos, Fromages de chèvre : la stratégie du leader français Soignon pour garder son avance, 04/04/2025
La France, premier producteur mondial de fromages de chèvre, est confrontée à une crise silencieuse mais préoccupante : la baisse continue de la production de lait caprin, qui menace l’approvisionnement des fromageries industrielles et artisanales. En 2024, la collecte a reculé de 3,2 %, atteignant 500 millions de litres, et l’année 2025 démarre encore plus mal avec une chute de 6 % en janvier. Les causes sont multiples, combinant des facteurs économiques, sociaux, climatiques et structurels.
Le principal problème réside dans la réduction du cheptel caprin, qui a perdu environ 100 000 têtes depuis 2020, pour ne plus compter que 1,25 million de chèvres et chevrettes. Cette décroissance s’explique par une vague massive de départs à la retraite des éleveurs, peu remplacés en raison de l’augmentation des coûts d’installation (+35 % en trois ans), notamment pour les bâtiments agricoles. Aujourd’hui, il faut compter environ 2 500 euros d’investissement par chèvre, contre moins de 2 000 avant la pandémie.
La filière est divisée entre deux modèles : la production fermière, qui représente 50 % des exploitations mais seulement 25 % du volume de lait, et les élevages livrant aux industriels, qui pèsent 75 % de la collecte. Or, ce sont ces derniers, plus gros, qui disparaissent le plus rapidement, fragilisant des marques comme Soignon, Chavroux ou Rians. Le manque de visibilité, le surmenage des nouveaux éleveurs, souvent néo-ruraux, et les difficultés à rentabiliser les circuits courts freinent les vocations durables.
Par ailleurs, les aléas climatiques (mauvaises récoltes de fourrage, manque de luminosité) et sanitaires (comme la FCO3, une fièvre virale touchant le Benelux) aggravent encore la situation. Résultat : les entreprises doivent se tourner vers l’importation de lait, en hausse de 38 % début 2025, malgré la pénurie également ressentie en Espagne, leur principal fournisseur.
À moyen terme, si la tendance se poursuit, la filière pourrait devoir faire des arbitrages douloureux en termes d’approvisionnement : seuls les clients capables de payer plus cher (grandes surfaces, marques premium, restauration) seront servis en priorité. Bien que les stocks de caillé permettent de tenir jusqu’à la fin de l’année 2025, les tensions pourraient exploser en 2026, mettant en péril la diversité et la disponibilité des fromages de chèvre dans les rayons français.
Le Monde, Gastronomie : la dure vie du durian (en Occident), 08/04/2025
En Asie du Sud-Est, le durian est vénéré comme le « roi des fruits ». Sa chair sucrée et complexe, évoquant à la fois l’amande et l’oignon doux, séduit les palais locaux. Pourtant, en Occident, ce fruit à l’odeur jugée nauséabonde déclenche gêne, moqueries, voire rejet. Son introduction sur les marchés français, notamment dans des pâtisseries parisiennes, soulève des interrogations sur la perception du goût et sur les frontières culturelles du plaisir gastronomique.
A Paris, plusieurs artisans, comme Christine Fu, cheffe pâtissière d’origine chinoise, revisitent ce fruit atypique dans des desserts raffinés : verrines à la vanille, choux à la crème ou encore panna cottas. Sa pâtisserie du 13ᵉ arrondissement défie les clichés, en intégrant des ingrédients peu familiers comme le pandan ou le kimchi, et en proposant une version accessible du durian, grâce à des textures crémeuses et sucrées qui atténuent sa puissance aromatique.
Le dégoût suscité par le durian est souvent culturel. Son parfum, comparé à celui d’un fromage trop fait, d’une poubelle en plein soleil ou de chaussettes sales, est dû à une forte teneur en éthanethiol, molécule soufrée identifiée en 2016 par des chercheurs. Cette odeur est si envahissante que le fruit est interdit dans de nombreux lieux publics asiatiques (hôtels, taxis, musées). Sur les réseaux sociaux, un « durian challenge » s’est même répandu, incitant les curieux à surmonter leur dégoût.
Malgré tout, des consommateurs occidentaux commencent à franchir le pas, attirés par l’exotisme, la curiosité sensorielle ou l’influence des cuisines asiatiques. Des boutiques comme La Pâtisserie de Choisy, tenue par la famille Mac, perpétuent une tradition venue du Cambodge, en adaptant le durian aux goûts des clients, notamment via des formats individuels et des associations avec des produits laitiers.
Le prix élevé du fruit en France – jusqu’à 100 euros pièce – et les contraintes logistiques (transport, conservation, odeur) freinent encore sa démocratisation. Mais l’intérêt grandissant pour les expériences gustatives fortes, tout comme le succès de produits fermentés ou ultra-pimentés, suggère que le durian pourrait bien gagner du terrain dans la gastronomie occidentale. En fin de compte, ce fruit controversé oblige à reconsidérer nos normes du bon goût, souvent façonnées par des habitudes locales plus que par des critères universels.
Les Échos, Il est frais votre poisson maturé ?, 05/04/2025
Une petite révolution agite les cuisines des restaurants gastronomiques : le poisson maturé. Longtemps symbole absolu de fraîcheur, le poisson est désormais parfois affiné pendant plusieurs jours voire semaines, pour développer des saveurs nouvelles, à l’instar de la viande ou du fromage. Cette tendance culinaire, inspirée des pratiques japonaises ancestrales, remet en cause les dogmes de la gastronomie occidentale.
Le chef Mauro Colagreco, triplement étoilé au Mirazur, fut l’un des pionniers en Europe. Dans son restaurant “Ceto”, aujourd’hui fermé, il a affiné des poissons jusqu’à 45 jours, obtenant une texture fondante et une concentration de goût remarquable. Selon lui, le poisson trop frais est chargé d’eau, tandis que l’affinage restitue l’humidité naturelle et permet d’atteindre un équilibre gustatif inédit.
D’autres chefs réputés adoptent cette approche : David Le Quellec chez Vive ou Katsutoshi Tomizawa au restaurant L’Abysse (groupe Yannick Alléno) transforment soles, sérioles ou thons en produits d’exception aux textures travaillées, entre fermentation douce, fumage et affinage sec. Les techniques sont précises : évacuation de l’humidité, contrôle de la température et de l’hygrométrie, parfois avec du sel de l’Himalaya pour stabiliser l’environnement.
Dans le même esprit, le couple Marie-Victoire et Arthur Viot a lancé une poissonnerie à Paris fondée sur l’affinage sans glace, réduisant les odeurs, la pénibilité du métier et sublimant la texture du poisson. Le succès est au rendez-vous : 800 000 euros de chiffre d’affaires en 2024, une activité de conseil en vitrines de maturation et bientôt l’ouverture d’un restaurant.
Mais cette innovation divise. Des chefs comme Christopher Coutanceau ou Jacques Maximin rappellent que tous les poissons ne se prêtent pas à l’affinage. Si certains gagnent en complexité (maquereau, bar), d’autres, comme le turbot ou les fruits de mer, perdent leur saveur originelle iodée. Pour ces professionnels, il ne faut pas céder à la mode au détriment du goût naturel.
Au fond, le poisson maturé incarne une évolution de la gastronomie, où l’on redécouvre le potentiel de la lenteur et des processus naturels, en écho à un monde en quête de sens et de durabilité. Mais comme pour toute innovation culinaire, il reste à définir s’il s’agit d’une révolution durable ou d’une simple tendance passagère.
Courrier International, L’avocat, thermomètre de l’état du monde, 07/04/2025
Devenu l’un des fruits les plus prisés au monde, l’avocat incarne à lui seul de nombreuses dynamiques sociales, économiques et écologiques du XXIe siècle. À travers un article de El País Semanal, le Courrier International expose comment ce fruit symbolise à la fois les nouveaux comportements alimentaires, les enjeux climatiques, les rapports de force commerciaux et même les problèmes de criminalité.
La variété Hass, qui domine 95 % du marché mondial, est appelée à devenir, d’ici 2030, le fruit le plus commercialisé au monde avec plus de 3,2 millions de tonnes/an. Apprécié pour sa richesse nutritionnelle, sa texture onctueuse et sa facilité d’utilisation, l’avocat séduit aussi bien les chefs que les influenceurs. Il incarne parfaitement les aspirations des classes moyennes urbaines occidentales vers une alimentation à la fois saine, végétale et tendance.
Cependant, son succès planétaire cache une réalité plus sombre. La culture de l’avocat est très gourmande en eau : il faut environ 1 000 litres d’eau pour produire un kilo de fruit. Dans des régions déjà confrontées à des stress hydriques (comme le Mexique ou le Chili), cette surexploitation aggrave les problèmes environnementaux et provoque des conflits d’usage. De plus, la déforestation galopante dans certaines zones est souvent liée à l’extension des cultures d’avocat.
L’impact social n’est pas en reste. Au Mexique, où 90 % des avocats consommés aux États-Unis sont produits, cette filière est infiltrée par le crime organisé, qui y voit une source de profits et un vecteur de blanchiment d’argent. Les “avocats de sang”, comme on les appelle, soulèvent des questions éthiques semblables à celles du diamant ou du cacao. Ce fruit est ainsi au cœur de tensions géopolitiques et criminelles, notamment dans le contexte des échanges entre le Mexique et les États-Unis.
Enfin, l’article souligne que la perception positive de l’avocat dans les pays développés occulte souvent ses conséquences globales. Il invite à une lecture critique : derrière un aliment jugé sain et esthétique, se cache un symbole ambivalent, reflet des contradictions de notre époque — entre bien-être personnel et ravages environnementaux, entre désir de nature et hyperconsommation mondialisée.
The Guardian, ‘Skyrocketing’ demand for matcha raises fears of shortage in Japan, 05/04/2025
Le matcha, cette poudre vert vif de thé vert japonais, connaît un succès planétaire fulgurant, dopé par les réseaux sociaux et une demande croissante en Europe, aux États-Unis et en Australie. Si ce phénomène profite aux producteurs japonais, il suscite également de fortes inquiétudes quant à la durabilité de l’approvisionnement, notamment à Uji, près de Kyoto, berceau historique de cette tradition.
Autrefois réservé à la cérémonie du thé (sadō) et aux palais initiés, le matcha est désormais partout : dans les lattés, desserts, bonbons, cosmétiques et même dans des plats comme les ramens ou les gyōzas infusés à la poudre verte. Cette montée en popularité a fait exploser la fréquentation de lieux culturels comme Chazuna, un parc-musée dédié au thé à Uji, où 90 % des visiteurs sont désormais des touristes étrangers.
La frénésie autour du matcha est également alimentée par son image bien-être : riche en antioxydants, modérément caféiné, perçu comme une alternative plus douce au café. Des influenceurs vantent ses vertus santé sur TikTok, où les contenus liés au matcha pullulent. En parallèle, des marques internationales surfent sur cette vague verte, provoquant une pression sans précédent sur la production locale.
Selon le ministère japonais de l’Agriculture, la production de matcha a triplé depuis 2010, atteignant 4 176 tonnes en 2023. Pourtant, les stocks s’amenuisent. À l’automne 2024, des restrictions d’achat ont été mises en place par les producteurs d’Uji face à la pénurie. Et la récolte de 2025, attendue avec impatience, ne devrait offrir qu’un répit temporaire.
Pour répondre à la demande, le gouvernement japonais envisage de subventionner les producteurs pour les inciter à délaisser le sencha (thé vert classique en feuilles) au profit du tencha, la variété utilisée pour produire du matcha. Cette réorientation agricole soulève des débats : faut-il sacrifier une tradition au profit d’une opportunité commerciale ? L’équilibre entre culture patrimoniale et adaptation économique devient un enjeu central.
En définitive, la trajectoire du matcha illustre une nouvelle fois les paradoxes de la mondialisation culinaire : un produit issu d’un art de vivre contemplatif se retrouve absorbé par une demande effrénée, où l’esthétique Instagram et les tendances alimentaires dictent désormais les rythmes de la production.
Financial Times, Want the coolest food in Japan? Head to the konbini, 07/04/2025
Au Japon, les konbini – ou convenience stores – sont bien plus que de simples supérettes : ils incarnent une véritable culture de consommation, à la croisée de la praticité, de l’innovation et du raffinement culinaire. Depuis l’importation des premières enseignes américaines (7-Eleven, Lawson, FamilyMart) dans les années 1970, le Japon a transformé ces petits commerces en véritables trésors gastronomiques accessibles 24h/24.
Les konbini remplissent une multitude de fonctions sociales : on y paie ses factures, envoie du courrier, fait des photocopies… mais surtout, on y mange très bien. Le cœur du système, c’est l’alimentation : une offre variée, fraîche, abordable, pensée autant pour les citadins pressés que pour les personnes âgées des zones rurales. On y trouve des onigiri, des bentō, des plats chauds comme le karaage (poulet frit sur place), du ramen, des poissons grillés, des desserts soignés, et une offre de plats régionaux comme le miso ramen à Hokkaido ou le tonkotsu à Kyushu.
L’article souligne à quel point ces lieux inspirent même des chefs professionnels. Brendan Liew, auteur du livre Konbini : Cult Recipes, Stories and Adventures from Japan’s Iconic Convenience Stores, explique que chaque passage dans un konbini est une sorte de chasse au trésor culinaire, tant la variété et la qualité des produits sont impressionnantes. Pour lui, ces magasins reflètent une forme d’ingéniosité japonaise : rendre le banal exceptionnel, et offrir du bon à tous, tout le temps.
La force des konbini réside aussi dans leur adaptabilité régionale : chaque enseigne ajuste son offre selon les goûts locaux, illustrant une finesse de compréhension du consommateur que peu d’acteurs mondiaux égalent. Leur modèle économique repose sur une logistique très réactive, des partenariats avec des artisans locaux, et un design de produit soigné jusque dans les emballages.
En somme, les konbini ne sont pas juste des magasins : ils sont devenus une vitrine du quotidien japonais, une leçon d’intégration du design, de la fonctionnalité et du plaisir de manger dans l’espace urbain. Et, paradoxalement, ce sont ces lieux de consommation de masse qui redonnent ses lettres de noblesse à la street food japonaise.
New York Times, Is the Restaurant Good? Or Does It Just Look Good?, 09/04/2025
À l’ère d’Instagram et des réseaux sociaux, une nouvelle forme d’évaluation gastronomique émerge : les restaurants sont-ils réellement bons… ou simplement photogéniques ? Cet article explore le décalage croissant entre l’apparence d’un plat ou d’un lieu et la qualité réelle de l’expérience culinaire, un phénomène devenu omniprésent dans les grandes villes.
Les plateformes visuelles comme Instagram ou TikTok dictent désormais les tendances en matière de restauration. Un établissement peut connaître un succès fulgurant grâce à un éclairage flatteur, une décoration soignée ou un plat esthétiquement séduisant, sans que le goût ou la cohérence de l’offre ne suivent. Pour beaucoup de jeunes consommateurs, le « moment photo » précède la dégustation, voire la remplace en importance. La recherche d’un plat « instagrammable » devient un critère déterminant dans le choix d’un restaurant.
Les restaurateurs eux-mêmes l’ont compris. Certains n’hésitent plus à concevoir leur décoration intérieure, leur vaisselle et même leurs recettes autour du rendu visuel sur écran. L’esthétique devient un argument commercial, parfois au détriment du goût ou de la générosité. Des plats sont calibrés pour le clic plutôt que pour la dégustation, créant une dissociation entre image et réalité.
Cependant, ce phénomène soulève des interrogations : est-ce encore de la gastronomie ou simplement une mise en scène ? Plusieurs critiques culinaires interrogés par le New York Times regrettent la perte de l’expérience sensorielle complète, où le goût, l’odeur, l’accueil et l’ambiance comptaient autant, voire plus, que la simple apparence. Ils dénoncent une standardisation de l’offre, où des plats similaires (avocado toast, lattes colorés, burgers XXL…) se retrouvent aux quatre coins du monde, déclinés pour l’écran plus que pour le palais.
Pour autant, le phénomène n’est pas nécessairement négatif. Il pousse certains chefs à soigner leur présentation, à innover visuellement, et à faire preuve de créativité pour attirer l’attention dans un marché saturé. L’enjeu devient alors de trouver un équilibre entre contenu viral et qualité réelle. Certains établissements, comme le rappellent les auteurs, parviennent à briller sur Instagram tout en offrant un niveau culinaire irréprochable.
En définitive, la question posée reste ouverte : à l’heure où l’image a pris le pouvoir dans l’alimentation, quelle place reste-t-il pour le goût ?
The Guardian, Cool condiments: ‘little treat culture’ leading to boom in preserves and sauces, 11/04/2025
Les condiments – confitures, sauces piquantes, mayonnaises aromatisées ou chutneys – connaissent un boom inédit, portés par la montée de la little treat culture, cette tendance à se faire plaisir avec de petits achats abordables mais sophistiqués. Un pot de confiture à 14 £ lancé par la marque lifestyle de Meghan Markle, épuisé en 30 minutes, symbolise cette nouvelle frénésie autour des produits d’accompagnement.
Cette dynamique rappelle le « lipstick effect » : en période d’incertitude économique, les consommateurs limitent leurs dépenses globales, mais s’offrent des plaisirs accessibles et valorisants. Les condiments, souvent situés autour de 10 £, deviennent des objets de désir, tant pour leur goût que pour leur esthétisme. Chez Delli, plateforme spécialisée dans les marques indépendantes, les ventes ont doublé en un an. Leurs best-sellers incluent du « croissant butter » à 10 £ ou une huile pimentée sino-malaisienne à 6,99 £. Même les grandes enseignes comme Waitrose, Marks & Spencer ou Ottolenghi surfent sur cette vague, avec des références haut de gamme comme la truffle mayo, le miso pesto ou la green harissa.
Le phénomène est amplifié par #CondimentTok, une branche culinaire de TikTok où les utilisateurs partagent leurs trouvailles, leurs « hauls » de sauces artisanales ou des idées pour réutiliser les jolis pots vides. Certains emballages – comme la sauce piquante de Brooklyn Beckham ou les cornichons de Goat Rodeo Goods – évoquent carrément des flacons de parfum de luxe.
Au-delà de l’image, ces produits sont plébiscités pour leur capacité à transformer des plats simples. Jake Normal, chef exécutif chez Ottolenghi, souligne que les condiments permettent de varier les saveurs sans multiplier les ingrédients ou le temps en cuisine. Claire Dinhut, autrice de The Condiment Book, propose même une nouvelle métrique : le « coût par bouchée » plutôt que le coût par portion.
Des restaurants comme Sambal Shiok, Koya ou Gymkhana proposent désormais leurs sauces maison à emporter, démocratisant ainsi des saveurs habituellement réservées aux repas sur place. Cette tendance révèle aussi une ouverture croissante à des condiments d’origines culturelles variées, comme les huiles pimentées asiatiques ou les chutneys indiens. Dinhut appelle d’ailleurs à éviter les raccourcis marketing : ces produits ne sont pas juste des modes passagères, mais des staples culturels enfin valorisés à leur juste place.
Même les grandes marques s’y mettent : Heinz a lancé une édition spéciale de ketchup en partenariat avec la marque de peinture Lick, tandis que Hellmann’s s’est associé à une griffe de mode pour un sac à main… conçu pour transporter un pot de mayo !
En résumé, les condiments deviennent des objets de style, de goût et d’identité, à mi-chemin entre luxe accessible, curiosité culinaire et phénomène de société, incarnant la nouvelle manière de consommer : petite, mais significative.
Eater, Why Everybody Was Obsessed With Quinoa in the Mid-2010s, 09/04/2025
Dans les années 2010, le quinoa est passé d’une céréale andine méconnue à une superstar des rayons bio et des restaurants healthy aux États-Unis et en Europe. Ce grain ancestral, cultivé depuis des millénaires par les populations indigènes de l’Altiplano – le haut plateau des Andes entre le Pérou et la Bolivie – est devenu l’emblème d’une alimentation saine, durable, riche en protéines… et potentiellement capable de résoudre famine mondiale et changement climatique. En 2013, l’ONU est même allée jusqu’à proclamer l’Année internationale du quinoa.
Pourtant, quelques décennies plus tôt, le quinoa était à peine connu en dehors de sa région d’origine. Il faut attendre les années 1980 pour que le produit entre dans les circuits alimentaires nord-américains, grâce à trois hippies du Colorado tombés amoureux de cette graine en voyageant en Bolivie. Ils fondent la marque Ancient Harvest, encore présente dans les rayons aujourd’hui. Mais jusqu’aux années 2000, le quinoa reste cantonné aux magasins de produits naturels et coopératives alternatives.
Son envol commence véritablement avec l’essor de la gastronomie péruvienne. Alors que le quinoa était auparavant perçu comme un aliment des classes rurales pauvres, des chefs de Lima décident dans les années 1980 de réhabiliter les produits andins dans une cuisine gastronomique ambitieuse, capable de rivaliser avec la haute cuisine française. Le quinoa apparaît alors sur les cartes de restaurants chics, dans des bières locales, et son image commence à changer au niveau mondial.
Parallèlement, la tendance du “bowl food”, les préoccupations pour la santé, et la recherche d’authenticité culinaire dans les pays riches favorisent sa percée : Buddha bowls, salades protéinées, barres énergétiques, biscuits, plats cuisinés… Le quinoa s’invite partout. Entre 2013 et 2014, son prix double, et les promesses d’une révolution agricole s’accélèrent.
Mais cette explosion soulève aussi des questions éthiques et économiques : les communautés agricoles qui cultivent le quinoa depuis des générations en bénéficient-elles réellement ? L’emballement autour de cette “graine miracle” a-t-il contribué à une amélioration des conditions de vie sur l’Altiplano ? Ou a-t-il créé une nouvelle forme d’injustice agroalimentaire, en déconnectant le produit de son ancrage local ? L’épisode de podcast Gastropod, dont l’article est issu, interroge précisément ces tensions entre succès global et enracinement local.
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A la semaine prochaine!
O. Frey