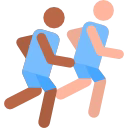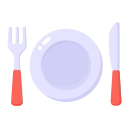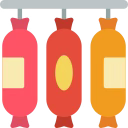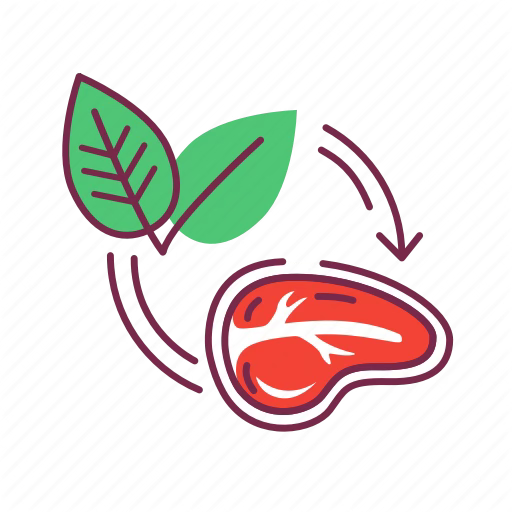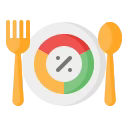🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2025-02
Bonjour à toutes et à tous, Eat's Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
Libération, Food Runners Club : courir, oui, mais vers une assiette de raclette, 18/01/2025
Le Monde, L’énigme des origines de la tartiflette, 12/01/2025
The Guardian, Calorie labels encourage people to eat less by only a single crisp, study says, 17/01/2025
Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
Libération, «Dry January» : les boissons sans alcool déboulent aussi dans la«haute gastronomie», 12/01/2025
Le Dry January s’étend désormais à la haute gastronomie. Cette tendance, encouragée par la Ligue contre le cancer, vise à promouvoir des alternatives sophistiquées aux classiques accords mets-vins. En 2024, plus de 4,5 millions de personnes ont participé au Dry January, une pratique en plein essor, qui impacte les modes de consommation, y compris dans les restaurants étoilés. Plusieurs chefs renommés ont ainsi intégré des boissons sans alcool dans leurs menus, ouvrant la voie à des accords innovants et créatifs.
Dans ce contexte, des boissons comme le kombucha, les eaux parfumées, les thés ou les cocktails sans alcool prennent une place de choix. Ces créations ne se contentent plus d’être des simples substituts : elles sont élaborées avec un soin équivalent à celui des vins. Par exemple, au restaurant Tracé, un kombucha maison aux herbes aromatiques est proposé pour accompagner un tartare de maquereau maturé, rivalisant avec un vin blanc floral de la vallée du Rhône. Ces options, servies à des prix accessibles, reflètent une volonté d’inclure une clientèle diversifiée, qu’il s’agisse de personnes suivant un régime sans alcool pour des raisons de santé, religieuses, ou simplement par choix.
La Ligue contre le cancer a mis en avant cette évolution à travers son initiative « Accords essentiels », réunissant sept chefs pour imaginer des menus complets sans alcool. Cette opération vise aussi à sensibiliser le public sur les risques liés à la consommation d’alcool, un facteur majeur de cancers, responsable de 28 000 cas par an en France et considéré comme le troisième facteur de morbidité au niveau mondial après le tabac et l’hypertension. Les statistiques révèlent que même une consommation modérée augmente les risques de cancers du sein, du foie, du côlon ou de l’œsophage.
Les boissons proposées dans ces menus excluent les sodas et les jus trop sucrés pour privilégier des saveurs plus adaptées à la gastronomie. Ainsi, ces accords non alcooliques s’inscrivent dans une double démarche de santé et de plaisir culinaire. Les chefs participants prouvent que la créativité gastronomique peut s’épanouir au-delà de l’alcool, offrant une expérience sensorielle unique et inclusive.
L’Usine Nouvelle, L'engouement pour le vin sans alcool profite à Chavin, dans l'Hérault, 12/01/2025
Le négoce de vins Chavin, situé dans l’Hérault, connaît un succès croissant grâce au segment des vins sans alcool, qui représente désormais plus de 50 % de son chiffre d’affaires. Depuis cinq ans, les ventes de ces produits enregistrent une croissance annuelle de 25 à 35 %, portée par une demande accrue en France et à l’international, avec des exportations vers 65 pays. En 2024, Chavin a réalisé un chiffre d’affaires global de 15 millions d’euros, une performance remarquable pour une entreprise de 20 employés.
La production de vin sans alcool repose sur des techniques complexes et coûteuses. Les vins sélectionnés pour la désalcoolisation doivent présenter une acidité équilibrée et des arômes puissants. Les cépages les plus adaptés incluent le muscat, le sauvignon blanc, le chardonnay et le cabernet-sauvignon. Une fois choisis, ces vins sont assemblés et passent par plusieurs étapes, notamment la distillation sous vide à basse température. Ce procédé permet d’extraire l’éthanol tout en préservant les arômes essentiels. Toutefois, le manque d’infrastructures adaptées en France oblige Chavin à externaliser une partie de ces opérations en Gironde ou en Espagne.
Malgré les coûts élevés, l’entreprise mise sur la qualité pour répondre aux attentes d’une clientèle exigeante. Mathilde Boulachin, fondatrice et présidente de Chavin, souligne que les consommateurs recherchent une expérience comparable à celle du vin traditionnel, et non un substitut sucré ou simpliste. La société stabilise ses produits grâce à des techniques innovantes, comme l’utilisation de tunnels de pasteurisation ou de dicarbonate de diméthyle.
Les Échos, L'utilisation des titres-restaurant pour les courses alimentaires finalement prolongée, 14/01/2025
Le dispositif permettant l’utilisation des titres-restaurant pour l’achat de denrées alimentaires brutes en supermarché a été prolongé pour deux années supplémentaires par le Sénat, après une adoption similaire par l’Assemblée nationale. Ce prolongement vient répondre à une demande forte des consommateurs modestes, pour qui ces titres représentent un soutien crucial en termes de pouvoir d’achat.
Le débat autour de cette mesure, qui concerne un marché estimé à 9,4 milliards d’euros, divise les acteurs économiques. Les grandes surfaces militent pour cette extension, car elle stimule leur chiffre d’affaires. En revanche, les restaurateurs s’opposent farouchement à cette mesure, qu’ils qualifient de « scandale ». Selon eux, la vente de produits bruts grâce aux titres-restaurant constitue un manque à gagner estimé à 576 millions d’euros pour le secteur de la restauration traditionnelle.
Véronique Louwagie, ministre déléguée aux PME, a salué cette décision, la qualifiant de mesure de simplification et de logique, largement plébiscitée par le grand public. Une étude menée en avril 2024 a révélé que 96 % des Français approuvent l’utilisation des titres-restaurant pour un large éventail de produits alimentaires. Cette réforme apporte une solution immédiate à l’incertitude qui planait sur les consommateurs depuis le début de l’année 2025, où l’usage des titres-restaurant pour des courses alimentaires avait été suspendu.
Cependant, cette prolongation ne met pas fin aux débats. Plusieurs voix appellent à une réforme globale du dispositif des titres-restaurant, qui devrait être discutée à l’été 2025. Parmi les pistes envisagées figurent la suppression des titres-restaurant au profit d’une augmentation des salaires nets, permettant une liberté totale d’utilisation pour les salariés. D’autres estiment qu’un recentrage sur la restauration pourrait mieux répondre à l’objectif initial de ces titres.
Libération, Food Runners Club : courir, oui, mais vers une assiette de raclette, 18/01/2025
Depuis l’automne 2024, une nouvelle tendance associe course à pied et gastronomie : des clubs comme le Food Runners Club proposent de courir plusieurs kilomètres avant de déguster des repas gourmands. À Paris, cet engouement a culminé avec une soirée « raclette à volonté », attirant une quarantaine de participants prêts à braver le froid pour combiner sport et plaisir culinaire.
Créé en novembre par deux passionnés, Théo Delahaye et Théo Chaudet, le Food Runners Club est rapidement devenu un phénomène avec 12 000 abonnés sur Instagram et une liste d’attente de 600 personnes pour les week-ends. Inspiré du Running Flan Club, fondé en septembre par deux frères testant des flans pâtissiers après leurs courses, le concept attire une communauté en quête de convivialité et d’originalité. Ces initiatives se multiplient en France, avec des variantes comme le Run Cheese Club à Paris ou le Food Running Club à Marseille.
L’objectif est de transformer la pratique sportive en une expérience sociale et gourmande. Pour les participants, comme Lauriane, 30 ans, « c’est plus fun qu’un club classique ». Des ingénieurs aux étudiants, beaucoup rejoignent ces groupes pour élargir leurs cercles sociaux, partageant des passions communes pour la course et la nourriture. Ces événements sont également une opportunité pour les restaurants partenaires, qui gagnent en visibilité via les réseaux sociaux tout en fournissant des portions adaptées à ces regroupements atypiques.
En parallèle, les clubs explorent des thèmes novateurs, comme un 10 km des boulangeries ou un 10 km de la bière, tout en garantissant une organisation rigoureuse. Le Running Flan Club, par exemple, a dû gérer des défis logistiques, allant jusqu’à avancer 1 720 euros pour des commandes de flans, suite à un succès dépassant les attentes.
Si l’idée d’associer course et gourmandise peut paraître paradoxale, les experts relativisent. Selon Véronique Rousseau, diététicienne à l’INSEP, « manger après l’effort est recommandé pour reconstituer les réserves d’énergie », bien que le type d’aliment consommé et la fréquence soient importants. Cependant, les organisateurs restent vigilants face aux troubles du comportement alimentaire (TCA). Théo Chaudet, lui-même ancien anorexique, veille à éviter toute obsession autour des calories au sein des groupes, insistant sur l’importance d’une approche équilibrée.
Malgré le froid et l’effort, l’ambiance festive l’emporte souvent. Raclette, concours de planches ou verres de vin animent les soirées post-course, où la convivialité prime. Avec des projets de développement ambitieux et une communauté grandissante, ces clubs illustrent une nouvelle manière d’aborder le sport, combinant plaisir, effort et partage.
Le Monde, L’énigme des origines de la tartiflette, 12/01/2025
La tartiflette, plat emblématique des stations de ski françaises, suscite curiosité et débats quant à son origine. Bien qu’elle semble ancestrale, cette recette savoyarde à base de reblochon, pommes de terre, lardons et oignons n’est apparue qu’au cours des années 1980. Aujourd’hui incontournable dans la culture culinaire française, son succès est pourtant entouré de mystères et d’hypothèses contradictoires.
Capitale autoproclamée du reblochon, la ville de Thônes en Haute-Savoie revendique être le berceau de la tartiflette. Pourtant, le Syndicat interprofessionnel du reblochon (SIR), souvent accusé d’avoir créé ce plat à des fins commerciales, nie être à l’origine de cette recette. Cette rumeur a été amplifiée par le critique gastronomique Christian Millau, qui a affirmé que le SIR avait imaginé la tartiflette pour « booster » le marché du reblochon, un fromage alors en forte croissance. Entre 1980 et 1990, la production de reblochon a bondi, passant de 6 000 à 10 000 tonnes par an, un contexte qui aurait favorisé l’apparition d’un plat valorisant ce produit.
Cependant, d’autres voix attribuent l’origine de la tartiflette à des traditions paysannes locales. Selon certaines versions, elle dériverait d’un plat ancien appelé « pèla », réalisé avec des reblochons imparfaits fondus sur des pommes de terre sautées. À Manigod, près de Thônes, une autre légende raconte que la famille Veyrat, dont est issu le célèbre chef étoilé Marc Veyrat, aurait perfectionné la recette en ajoutant lardons, oignons et vin blanc, et en lui donnant le nom évocateur de « tartiflette ».
Malgré les controverses, la tartiflette est devenue un symbole de convivialité et de gastronomie hivernale. Son succès commercial, amplifié par des initiatives marketing comme les « tartiflettes géantes » et le slogan « In tartiflette we trust », a également engendré des dérives. De nombreuses versions industrielles du plat, utilisant peu ou pas de reblochon, ont envahi les supermarchés, dénaturant parfois la recette originale.
Le Monde, Retour gagnant pour la cuisine d’antan, 16/01/2025
La cuisine française de tradition, longtemps éclipsée par les tendances de la bistronomie et de la fusion, connaît un renouveau spectaculaire. Partout en France, chefs et restaurateurs redécouvrent les plats classiques et les codes de la grande gastronomie d’autrefois. Ce retour aux sources s’appuie sur une quête de nostalgie et d’authenticité répondant à une demande croissante de confort et de valeurs patrimoniales.
Frédéric Anton, chef triplement étoilé du Pré Catelan à Paris, illustre cette tendance avec « La Ferme du pré », un bistrot où il revisite les codes de 1900. Dans un cadre rustique, les plats proposés, comme les rognons de veau sauce madère ou le boudin noir, célèbrent les savoir-faire oubliés et les traditions culinaires françaises. Selon Frédéric Anton, l’objectif n’est pas de réinventer ces plats, mais de les exécuter avec précision et respect des recettes d’origine, s’appuyant sur des ouvrages de référence tels que ceux d’Auguste Escoffier.
Jean-François Piège, autre figure emblématique de la gastronomie française, partage cet engouement avec son établissement parisien « La Poule au pot ». Ici, les plats sont ancrés dans les traditions régionales : quenelle de brochet sauce Nantua, crêpes Suzette flambées ou encore soupe à l’oignon préparée selon des méthodes artisanales. Ces propositions rencontrent un succès important malgré un coût élevé, justifié par l’utilisation d’ingrédients de qualité et de techniques exigeantes.
Cependant, ce retour à la cuisine d’antan suscite des débats. Alain Ducasse, fervent défenseur de l’innovation, voit dans cette tendance un repli sur le passé, potentiellement au détriment de la créativité. Pourtant, des figures comme Jean Imbert, qui modernise les classiques au sein du Plaza Athénée, démontrent que tradition et modernité peuvent coexister. Ce dernier mêle des recettes anciennes, comme le gratin de daurade de 1962, à des présentations contemporaines et des produits premium.
Ce phénomène s’inscrit dans un contexte où les repères culinaires sont redéfinis. Pour certains chefs, il s’agit de transmettre un patrimoine gastronomique en voie de disparition, tandis que pour d’autres, la tradition devient un outil de marketing. Quoi qu’il en soit, la cuisine de tradition séduit par son ancrage émotionnel et sa capacité à rappeler un passé où le repas était un véritable rituel.
L’Usine Nouvelle, Pas de « Normandie » pour le camembert pasteurisé, 15/01/2025
La cour administrative d’appel de Nantes a confirmé que les références à la Normandie sur les étiquettes de camemberts sont strictement réservées aux fromages bénéficiant de l’Appellation d’Origine Protégée (AOP) « Camembert de Normandie ». Cette décision marque un tournant dans les litiges opposant depuis plusieurs années des industriels, comme Lactalis, à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Ces entreprises utilisaient des mentions telles que « Fabriqué en Normandie » ou « Au bon lait normand » sur des camemberts pasteurisés, suscitant des accusations de tromperie envers les consommateurs.
L’affaire s’appuie sur le règlement européen n° 1151/2012, qui protège les dénominations liées aux AOP contre toute imitation ou usurpation. Selon la cour, ces mentions pourraient induire les consommateurs en erreur en leur faisant croire que ces produits respectent les critères stricts de l’AOP, qui impose notamment l’utilisation de lait cru et des méthodes de production traditionnelles. Le jugement, salué par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) et le Conseil National des Appellations d’Origine Laitières (CNAOL), trace des lignes claires pour les industriels, les invitant à cesser toute utilisation abusive de la référence à la Normandie.
Cette décision a des implications économiques importantes. Les entreprises concernées devront revoir leurs étiquetages, un processus coûteux, notamment pour les camemberts pasteurisés qui constituent une part significative des ventes de fromages français à l’international. Cependant, des exceptions existent : certaines marques, comme « Le Père normand » de Savencia ou « Le Fameux normand » de Lactalis, bénéficient de droits acquis car elles étaient enregistrées avant l’entrée en vigueur de l’AOP en 1994.
Les défenseurs de l’AOP voient dans ce verdict une victoire pour la préservation des traditions fromagères et pour la protection des consommateurs. Ils espèrent que cette clarification des règles renforcera la reconnaissance des produits de qualité. Néanmoins, cette affaire illustre les tensions entre respect des terroirs et stratégies commerciales, dans un secteur où les enjeux financiers et culturels se croisent.
La Tribune, La Belle Aude, les glaces made in Occitanie qui résistent à la crise, 08/01/2025
La Fabrique du Sud, coopérative fondée par d’anciens salariés de l’usine Pilpa à Carcassonne, célèbre les dix ans de sa marque de glaces artisanales, La Belle Aude. Cette aventure coopérative a émergé en 2013 suite à la fermeture annoncée du site industriel par son propriétaire. Avec pour ambition de produire des glaces qualitatives et régionales, la Scop (société coopérative et participative) a su se démarquer malgré les turbulences économiques, notamment la hausse des coûts des matières premières et une conjoncture difficile en 2022 et 2023.
La Belle Aude s’appuie sur des circuits courts et des ingrédients de qualité pour proposer une gamme de 25 parfums, dont trois biologiques. La vanille reste son produit phare et représente 16 % des ventes. La coopérative produit entre 6 000 et 10 000 pots par jour, distribués dans environ 400 points de vente, principalement en Occitanie. Cependant, les ventes en volume ont souffert en 2023, impactées par une météo défavorable et des ajustements stratégiques comme la réduction des promotions en grandes surfaces. Ces facteurs ont entraîné un chiffre d’affaires de 3,1 millions d’euros, inférieur aux prévisions initiales.
Pour 2025, la Fabrique du Sud mise sur deux axes : l’ouverture au secteur de la restauration premium et la production en marque blanche. Une collaboration prometteuse avec un partenaire majeur est d’ailleurs en cours de finalisation. Par ailleurs, une personne sera dédiée à la prospection de nouveaux clients dans la restauration collective et haut de gamme, avec un accent sur le littoral méditerranéen.
La coopérative adopte également une démarche de clean-label, en éliminant les additifs artificiels et en privilégiant des stabilisants naturels. Ce positionnement répond à la demande croissante des consommateurs pour des produits plus sains et respectueux de l’environnement. Cependant, le projet de construction de nouveaux locaux, initialement estimé à 2,5 millions d’euros, reste en suspens jusqu’à une amélioration significative des performances économiques.
Les Échos, Petit basque, Malo, La Potagère : avec son nouvel actionnariat, Sill Entreprises prépare un pas de géant, 17/01/2025
Le groupe agroalimentaire breton Sill Entreprises, basé à Plouvien dans le Finistère, se fixe un objectif ambitieux : atteindre un chiffre d’affaires de 900 millions d’euros d’ici 2030, contre 650 millions en 2024. Connu pour ses marques emblématiques comme Malo, Le Petit Basque, et La Potagère, le groupe se prépare à un développement stratégique majeur grâce à une récente réorganisation de son capital.
Trois nouveaux investisseurs, IDIA Capital Investissement, Unexo (groupe Crédit Agricole), et Société Générale Capital Partenaires, remplacent les partenaires historiques du groupe, dont Crédit Mutuel Arkéa et Unigrains. Cette opération, bien que les détails financiers n’aient pas été divulgués, laisse la majorité du capital (86 %) sous le contrôle des familles fondatrices Falch’un et Leon, ainsi que de Sébastien Floc’h, président du directoire de Sill. Ce nouvel actionnariat vise à soutenir la croissance organique et externe du groupe.
Sill Entreprises souhaite renforcer ses positions dans plusieurs segments : les produits laitiers frais, les surgelés, les jus, les produits de nutrition et surtout les soupes liquides. Cette dernière catégorie, où Sill ambitionne de devenir un leader européen, a bénéficié de l’acquisition en 2024 des activités « potages et soupes liquides » de Knorr en France, précédemment détenues par Unilever. Le groupe s’appuie sur un ancrage local fort, notamment grâce à un partenariat avec Altho Brets, qui sécurise l’approvisionnement de 20 000 tonnes de pommes de terre, offrant une filière complémentaire pour les agriculteurs locaux.
Sur le plan industriel, Sill prévoit d’investir annuellement entre 15 et 20 millions d’euros dans ses infrastructures pour soutenir son expansion. À l’international, le groupe, qui réalise déjà 20 % de son chiffre d’affaires hors de France, prépare l’ouverture d’un bureau à Houston, au Texas, en 2025. Cette implantation vise à exploiter le marché américain des produits frais et des desserts, identifié comme une opportunité clé. En parallèle, Sill Entreprises envisage trois à quatre acquisitions d’ici 2030 pour accélérer sa croissance externe.
Avec cette stratégie ambitieuse, Sill Entreprises ne se contente pas de consolider sa position en France. En misant sur l’innovation, l’expansion internationale et l’intégration locale, le groupe breton aspire à devenir un acteur majeur sur la scène agroalimentaire européenne et mondiale.
Modern Retail, How Gregorys Coffee is taking the craft coffee business to scale, 09/01/2025
Depuis sa création en 2006 à New York, Gregorys Coffee s’est imposée comme une chaîne de cafés mêlant qualité artisanale et commodité, avec plus de 50 établissements aux États-Unis. Fondée par Gregory Zamfotis, la marque s’est développée à l’intersection de la troisième vague du café – axée sur la spécialisation et la qualité – et de la demande pour un service rapide et pratique. Contrairement aux grands noms comme Starbucks, Gregorys a adopté une approche hybride qui combine expérience premium et efficacité.
Lors de ses débuts, la marque a intégré des innovations comme le latte art, les méthodes d’extraction manuelle et les cafés d’origine unique, des éléments devenus des standards dans l’univers du café artisanal. Cependant, la pandémie a bouleversé le secteur. Alors que de nombreuses enseignes se concentraient sur des formats minimalistes et axés sur la rapidité (comme les espaces réduits ou le service drive-through), Gregorys a choisi une direction opposée en investissant dans de grands espaces conçus pour être des lieux de convivialité et de détente.
L’année 2024 a été marquée par une expansion rapide, notamment grâce à un partenariat stratégique avec Simon Property Group. Ce partenariat a permis à Gregorys d’ouvrir 15 nouveaux établissements dans des emplacements stratégiques, réduisant ainsi le temps nécessaire pour pénétrer de nouveaux marchés. Gregory Zamfotis souligne que cette expansion rapide n’a pas compromis la qualité, grâce à une attention minutieuse portée aux processus et à la formation des équipes.
La chaîne se distingue également par son engagement à proposer un menu innovant qui reflète les attentes des consommateurs modernes. Gregorys offre des produits saisonniers, des options végétaliennes et sans gluten, tout en maintenant une expérience café haut de gamme. Cette stratégie, combinée à une forte présence numérique et à des applications mobiles conviviales, renforce sa compétitivité face aux géants du secteur.
The Guardian, Sparkling tea sales soar as Britons seek healthy options for festive fizz, 10/01/2025
En pleine évolution des habitudes de consommation, le thé pétillant gagne en popularité au Royaume-Uni en tant qu’alternative saine et élégante aux boissons alcoolisées traditionnelles. Ce phénomène s’inscrit dans une tendance plus large de réduction de la consommation d’alcool, particulièrement marquée lors de campagnes comme le Dry January. Le thé pétillant, présenté comme une boisson festive avec des propriétés de bien-être, remplace de plus en plus le champagne lors des célébrations.
Des marques comme Real, spécialisée dans les thés pétillants haut de gamme, connaissent une forte croissance. Pendant les fêtes de fin d’année 2024, les ventes de leurs produits phares, comme le Dry Dragon (à base de thé vert) et le Peony Blush (à base de thé blanc), ont augmenté respectivement de 72 % et 60 % sur des plateformes comme Ocado et Waitrose. Avec des prix allant de 10 à 17 £ par bouteille, ces produits se positionnent comme une alternative sophistiquée au vin, bénéficiant de saveurs complexes issues de la fermentation ou de la carbonatation.
Outre le segment haut de gamme, le thé se diversifie également avec des offres adaptées à la consommation quotidienne. Des marques comme Twinings proposent des thés pétillants en canettes, enrichis de jus de fruits et de vitamines, ciblant un public soucieux de sa santé. Ces produits, bien qu’assez coûteux (près de 2 £ la canette), trouvent leur place dans les rayons des supermarchés, souvent inclus dans des offres de repas.
Cette évolution reflète un changement culturel majeur. Alors que la consommation traditionnelle de thé décline rapidement – avec une baisse de près de 20 % depuis 2020 – les Britanniques adoptent de nouvelles façons de consommer cette boisson. Le thé est désormais perçu comme un ingrédient clé pour les boissons modernes, y compris les thés fermentés comme le kombucha ou les thés énergisants.
Cependant, le thé pétillant fait face à un défi majeur : son prix. Plus de la moitié des adultes interrogés estiment que le coût des alternatives sans alcool, y compris le thé pétillant, est un frein à leur adoption. Malgré cela, l’intérêt croissant pour des boissons sans alcool, savoureuses et respectueuses de la santé, positionne le thé pétillant comme une catégorie prometteuse dans un marché en mutation.
Washington Post, Processed meats don’t just affect your heart. They may worsen cognition, too., 16/01/2025
Une nouvelle étude publiée dans la revue Neurology suggère un lien entre la consommation régulière de viandes rouges transformées, comme le bacon, les saucisses et le salami, et un risque accru de déclin cognitif et de démence. Ces résultats renforcent les recommandations sanitaires visant à limiter la consommation de ces aliments, déjà associée à des maladies cardiovasculaires, des cancers et le diabète de type 2.
L’étude, menée sur plus de 133 000 participants suivis pendant plus de 40 ans, a évalué leurs habitudes alimentaires et leur santé cognitive. Les tests incluaient des mesures de mémoire, de rappel et de fonction cognitive, ainsi qu’un suivi des diagnostics de démence. Les résultats montrent qu’une consommation quotidienne d’au moins un quart de portion de viande transformée (environ 21 grammes) augmente de 13 % le risque de démence et de 14 % le risque de déclin cognitif subjectif. Chaque portion supplémentaire de viande transformée est associée à un vieillissement cognitif équivalent à 1,69 an.
Les chercheurs expliquent que ce lien pourrait s’expliquer par les niveaux élevés de sodium, de graisses saturées et d’additifs chimiques tels que les nitrates et nitrites dans ces produits. Ces substances peuvent augmenter la pression artérielle et provoquer des problèmes vasculaires affectant le cerveau. En revanche, la consommation de viandes rouges non transformées, comme le bœuf ou l’agneau, n’a pas été corrélée à un risque accru de déclin cognitif.
L’étude met également en lumière des stratégies pour réduire ces risques. Remplacer une portion de viande transformée par des sources de protéines végétales, telles que les noix ou les légumineuses, est associé à une réduction de 19 % du risque de démence et à un ralentissement du vieillissement cognitif. Substituer ces viandes par du poulet ou du poisson s’avère également bénéfique.
The Guardian, Calorie labels encourage people to eat less by only a single crisp, study says, 17/01/2025
Une nouvelle étude met en lumière l’impact limité des étiquettes caloriques sur les comportements alimentaires. Bien que l’ajout d’informations caloriques sur les menus et les emballages soit censé inciter à une consommation plus saine, l’effet réel serait minime. Selon les chercheurs, ces étiquettes encourageraient une réduction moyenne d’à peine une calorie par choix alimentaire.
L’étude, menée par des universitaires britanniques, s’appuie sur des données collectées dans des contextes réels, tels que des chaînes de restauration rapide et des supermarchés. Elle révèle que, bien que les consommateurs soient conscients des informations caloriques, cette prise de conscience n’entraîne pas de changements significatifs dans leurs habitudes alimentaires. Les motivations comportementales, les préférences gustatives et le prix des produits restent les facteurs déterminants.
Les résultats soulèvent des questions sur l’efficacité des politiques de santé publique axées sur la transparence nutritionnelle. Introduites pour lutter contre l’obésité croissante, les étiquettes caloriques étaient perçues comme une mesure simple et directe pour responsabiliser les consommateurs. Cependant, leur impact limité pousse les experts à repenser les approches en matière de nutrition. Certains suggèrent de combiner ces étiquettes avec d’autres stratégies, comme la réduction des portions ou des taxes sur les aliments riches en sucre et en graisses.
Malgré leur effet modeste, les étiquettes caloriques ne sont pas sans bénéfices. Elles sensibilisent les consommateurs et les encouragent à réfléchir à leurs choix alimentaires. Pour certains groupes, en particulier les individus soucieux de leur santé ou suivant des régimes spécifiques, ces informations peuvent influencer leurs décisions de manière plus significative.
Les critiques de cette mesure soulignent qu’elle place une trop grande responsabilité sur les consommateurs, en occultant le rôle des industries agroalimentaires dans la production de produits ultra-transformés. Une approche plus globale, incluant des initiatives éducatives et des réglementations sur la composition des aliments, pourrait avoir un impact plus substantiel sur la santé publique.
New York Times, Yes, Imitation Meat Is Processed. Can It Also Be Healthy?, 16/01/2025
L’essor des viandes végétales transformées, telles que celles proposées par Beyond Meat ou Impossible Foods, a suscité de nombreuses interrogations sur leur impact sur la santé. Ces alternatives, conçues pour imiter la texture et le goût des viandes animales, sont souvent critiquées pour leur degré élevé de transformation. Cependant, leur potentiel pour promouvoir une alimentation durable et réduire la consommation de viande est également souligné.
Les substituts de viande sont généralement composés de protéines végétales, comme le pois ou le soja, associées à des additifs tels que des huiles, des arômes artificiels et des agents de texture. Cette composition, bien qu’innovante, les positionne dans la catégorie des aliments ultra-transformés, suscitant des inquiétudes quant à leur qualité nutritionnelle. Certains nutritionnistes alertent sur la teneur élevée en sodium et en graisses saturées de ces produits, qui pourraient neutraliser leurs bénéfices pour la santé.
Néanmoins, des études récentes montrent que remplacer la viande animale par ces alternatives peut présenter des avantages significatifs. Une recherche de l’Université de Stanford a révélé que les participants ayant adopté une alimentation riche en viandes végétales ont vu leur cholestérol baisser et leur santé cardiovasculaire s’améliorer. Ces produits peuvent également contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation de ressources naturelles, renforçant ainsi leur intérêt dans une perspective environnementale.
Pour maximiser leurs bienfaits, les experts recommandent de privilégier des viandes végétales fabriquées avec des ingrédients simples et naturels, et de les consommer dans le cadre d’une alimentation équilibrée. Les entreprises du secteur, conscientes de ces critiques, investissent dans des formulations plus saines, intégrant des protéines complètes et limitant les additifs.
En dépit des controverses, les viandes végétales transformées restent un outil prometteur pour répondre à des enjeux globaux, qu’ils soient liés à la santé, à l’environnement ou à l’éthique animale. Leur succès dépendra cependant de leur capacité à évoluer vers des produits moins transformés et plus alignés avec les attentes des consommateurs soucieux de leur bien-être.
New Yorker, Why The American Diet is so Deadly, 06/01/2025
L’alimentation américaine, souvent critiquée pour ses excès, est pointée comme un facteur clé de nombreuses maladies chroniques, notamment l’obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Cet article examine les raisons pour lesquelles cette diète est si nocive, en explorant les choix alimentaires, les politiques publiques et les influences culturelles qui façonnent les habitudes des Américains.
L’une des principales causes identifiées est la prévalence des aliments ultra-transformés dans l’alimentation quotidienne. Ces produits, riches en sucres, graisses saturées et additifs, représentent une part disproportionnée des calories consommées par la population. Leur accessibilité et leur faible coût en font des options privilégiées, particulièrement dans les communautés à faibles revenus, où l’accès à des aliments frais et sains est limité.
Les politiques agricoles américaines jouent également un rôle important. Depuis des décennies, les subventions gouvernementales favorisent la production de cultures comme le maïs et le soja, utilisés pour fabriquer des ingrédients bon marché tels que le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Ce modèle économique soutient l’industrie des aliments transformés, tout en rendant les options nutritives moins compétitives en termes de prix.
L’article met également en lumière l’impact de la publicité et du marketing, notamment auprès des enfants. Les campagnes promotionnelles des grandes entreprises agroalimentaires ciblent souvent les jeunes consommateurs, les exposant dès le plus jeune âge à des aliments pauvres en nutriments. Parallèlement, les portions servies dans les restaurants et les supermarchés ont considérablement augmenté au fil des décennies, encourageant la surconsommation.
Pour remédier à ces problèmes, des experts plaident pour des réformes structurelles, notamment des subventions pour les fruits et légumes, des campagnes éducatives sur la nutrition et des réglementations plus strictes concernant le marketing alimentaire. Certains États ont déjà adopté des politiques innovantes, comme la taxation des sodas ou l’imposition de normes nutritionnelles dans les écoles.
Malgré ces efforts, le changement reste difficile en raison de l’influence des lobbies industriels et des habitudes culturelles profondément ancrées. Cet article conclut que pour améliorer la santé publique, il ne suffit pas de responsabiliser les individus ; une transformation du système alimentaire et des politiques publiques est essentielle pour rendre une alimentation saine accessible à tous.
CNBC, Companies from Coca-Cola to Anheuser-Busch are getting in on the canned cocktail market. Here’s why, 10/01/2025
Le marché des cocktails en canettes connaît une croissance fulgurante aux États-Unis. En 2023, plus de 62 millions de caisses de spiritueux prêts à boire ont été consommées, marquant une augmentation de près de 25 % par rapport à 2022. Cette catégorie est devenue la deuxième plus importante en volume, juste derrière la vodka, et témoigne de l’évolution des préférences des consommateurs.
L’engouement pour les boissons prêtes à boire a commencé avec le lancement de White Claw en 2016, qui a rapidement dominé le marché grâce à son positionnement en tant qu’alternative à la bière light. Toutefois, le marché des boissons à base de malt, comme les seltzers, a atteint un point de saturation. Une prolifération de nouvelles marques et de saveurs complexes a dilué leur attrait initial, provoquant une baisse de 8 % des parts de marché des boissons à base de malt entre 2021 et 2023. En revanche, les cocktails en canette à base de spiritueux (vodka, tequila ou gin) ont progressé de 8 % sur la même période.
Les cocktails en canette attirent non seulement les consommateurs, mais aussi les grandes entreprises. Plus de la moitié du marché américain des spiritueux prêts à boire est dominée par trois marques principales : High Noon, détenue par Gallo, ainsi que Cutwater et Nutrl, qui appartiennent au géant de la bière Anheuser-Busch InBev. Bien que le segment « au-delà de la bière » (incluant les boissons à base de malt et de spiritueux) représente moins de 5 % des ventes aux États-Unis pour Anheuser-Busch et environ 7 % pour Molson Coors, sa croissance exponentielle au cours des cinq à sept dernières années témoigne d’un potentiel inexploité. Outre les géants de la bière, d’autres acteurs entrent sur ce marché prometteur. Coca-Cola s’est associée à Brown-Forman pour lancer une version en canette du classique Jack Daniel’s et Coca-Cola. Cette incursion dans les boissons alcoolisées reflète une stratégie visant à diversifier les portefeuilles et capter une part du marché des spiritueux.
Malgré leur succès croissant, ces boissons restent un défi pour les grandes entreprises. Les analystes soulignent que, malgré des tendances positives, les prix des actions des géants de la bière n’ont pas suivi, traduisant un décalage entre la croissance du segment et sa contribution financière réelle.
The Guardian, How gen Z helped drink Guinness dry – and its stout rivals cashed in, 18/01/2025
Guinness, autrefois perçu comme une bière pour les générations plus âgées, connaît une renaissance spectaculaire grâce à la Génération Z, les femmes et des célébrités influentes comme Kim Kardashian et Olivia Rodrigo. En 2024, les ventes de Guinness ont bondi de 20 % en novembre par rapport à la même période l’année précédente, poussant la marque à doubler sa production pour répondre à une demande croissante. Cependant, cette popularité inattendue a entraîné une pénurie dans de nombreux pubs britanniques, ouvrant la voie à des stouts rivaux comme Murphy’s et Brennan’s.
Le succès de Guinness peut être en partie attribué à sa présence sur les réseaux sociaux, avec des comptes comme Shit London Guinness qui attirent l’attention sur des aspects humoristiques ou techniques liés à la boisson, et des défis comme le « splitting the G ». Ces tendances ont transformé Guinness en une boisson tendance auprès des jeunes et des femmes, dépassant son image traditionnelle de bière d’“homme d’âge mûr”. Guinness 0.0, sa version non alcoolisée, est devenue la bière sans alcool la plus vendue au Royaume-Uni, témoignant d’une demande accrue pour des alternatives modernes.
Cependant, cette pénurie a ouvert une opportunité pour d’autres stouts. Murphy’s, appartenant à Heineken, a connu une augmentation massive de ses ventes dans les pubs britanniques, avec une hausse de 632 % en décembre 2024 par rapport à l’année précédente. Sa campagne publicitaire humoristique « Good things come to those who are waiting » a également aidé à capter l’attention des amateurs de stout. La marque est désormais présente dans plus de 500 pubs au Royaume-Uni et prévoit d’élargir son offre avec des canettes. D’autres brasseries profitent également de la situation. Brennan’s, une stout produite en Irlande, a collaboré avec la brasserie britannique Theakston pour intensifier sa distribution au Royaume-Uni après le Brexit. En décembre 2024, Brennan’s a vendu trois à quatre mois de stock en seulement deux semaines, atteignant 100 000 pintes consommées cette année-là. Ce chiffre pourrait grimper à 250 000 en 2025.
Malgré ce succès temporaire pour les concurrents, Diageo, propriétaire de Guinness, s’efforce de stabiliser l’approvisionnement, notamment en augmentant les exportations vers le Royaume-Uni. Alors que Guinness reste la marque dominante sur le marché des stouts, cette situation souligne comment les tendances des consommateurs et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement peuvent remodeler un marché et offrir des opportunités à des acteurs plus petits.
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A la semaine prochaine!
O. Frey