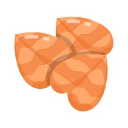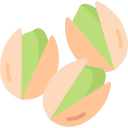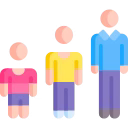🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2025-01
Avant de commencer cette première newsletter de l’année (et la 200è depuis que Eat’s Business existe) je vous souhaite à toutes et tous une belle et heureuse année 2025. Comme le disait Brillat-Savarin : “La découverte d’un mets nouveau fait plus pour le bonheur du genre humain que la découverte d’une étoile.” Puisse 2025 être remplie d’étoiles dans vos assiettes, de moments conviviaux autour d’une table généreuse, et d’instants gourmands partagés avec ceux qui vous sont chers.
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
Le Monde, Le sarrasin, petite graine aux grandes vertus, 09/01/2025
Libération, Vanille locale, cookie au foin, galette des rois à la tagète… La pâtisserie écolo veut faire sa part, 10/01/2025
Wall Street Journal, Does French Flour Make Better, Healthier Bread, or Is It Just Hype?, 07/01/2025
Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
Avant de commencer la revue de presse, le monde gastronomique français a perdu deux figures emblématiques en moins d’un mois. J’ai sélectionné deux articles qui retracent leurs parcours.
Le Monde, Jean-Luc Petitrenaud, journaliste gastronomique, est mort, 10/01/2025
Jean-Luc Petitrenaud, célèbre journaliste gastronomique et visage familier du petit écran, est décédé à l’âge de 74 ans. Cette figure emblématique avait marqué des générations de téléspectateurs grâce à ses émissions télévisées, notamment « Carte postale gourmande » sur France 5 (2000-2006) et « Les Escapades de Petitrenaud » (2006-2017). Avec son style truculent et généreux, il a fait découvrir les trésors du patrimoine culinaire français, des artisans locaux aux produits d’exception.
Originaire de Clermont-Ferrand, Petitrenaud avait un parcours atypique : formé en chaudronnerie, éducateur spécialisé et ancien élève de l’école de cirque d’Annie Fratellini, il s’était finalement tourné vers sa passion pour la gastronomie. Il avait également animé « Le Bistrot du dimanche » sur Europe 1 de 1998 à 2014 et écrit des critiques gastronomiques pour L’Express dans les années 1990-2000. Auteur prolifique, il avait publié plusieurs ouvrages célébrant la cuisine française, notamment Bienvenue chez moi (2016), où il partageait ses souvenirs d’enfance et son amour pour les saveurs simples et authentiques. Sa carrière s’est construite autour de la mise en lumière des terroirs et savoir-faire français. À travers son travail, il a célébré l’imagination et la créativité des cuisiniers de tous horizons, incarnant un pont entre tradition et modernité.
Libération, Mort de Maïté à 86 ans, la cuisine rustique servie en plateau, 21/12/2025
Maïté, figure emblématique de la cuisine française à la télévision, s’est éteinte à l’âge de 86 ans. De son vrai nom Marie-Thérèse Ordonez, elle a marqué des générations de téléspectateurs grâce à son style chaleureux et sa défense des recettes traditionnelles du Sud-Ouest. Animatrice emblématique de l’émission « La Cuisine des Mousquetaires » sur France 3 dans les années 1980 et 1990, Maïté incarnait une certaine idée de la cuisine française, généreuse, simple et authentique. Ses émissions, souvent ponctuées de moments cocasses, ont fait d’elle une icône populaire. On se souvient notamment de ses démonstrations audacieuses, comme lorsqu’elle assommait des anguilles vivantes ou préparait des plats en utilisant des techniques oubliées.
En dehors de la télévision, Maïté était une fervente promotrice des produits locaux et du terroir. Elle a publié plusieurs livres de recettes et tenu un restaurant à Rion-des-Landes, où elle accueillait ses clients avec le même enthousiasme que sur le petit écran. Son attachement à la cuisine du Sud-Ouest et aux valeurs de partage et de convivialité a laissé une empreinte durable dans le cœur des amateurs de gastronomie. Cependant, Maïté a également été critiquée pour son style parfois caricatural et les polémiques sur certaines pratiques culinaires aujourd’hui jugées inacceptables, comme l’abattage à l’ancienne de certains animaux. Avec sa disparition, c’est une page de l’histoire culinaire française qui se tourne.
Les Échos, La pomme de terre française triomphe à l'étranger, 07/01/2025
Les exportations françaises de pommes de terre ont atteint des niveaux records pour la campagne 2023-2024, renforçant la position de la France comme premier exportateur mondial. En volume, les exportations ont augmenté de 10 % pour atteindre 3,5 millions de tonnes, soit la moitié de la production nationale, et de 28 % en valeur, franchissant la barre d’un milliard d’euros. Cette croissance spectaculaire s’explique par une forte demande européenne, notamment en Belgique, principal importateur, ainsi qu’en Espagne et en Italie.
La Belgique, avec ses achats massifs destinés aux industriels pour la production de frites et autres produits surgelés, reste le premier débouché de la France et absorbe près de 1,7 million de tonnes. L’Espagne et l’Italie complètent le podium, mais c’est la demande des Pays-Bas qui surprend le plus avec une augmentation spectaculaire de 97 %. Cette tendance est attribuée à une chute de la production néerlandaise causée par la réduction des surfaces cultivées et des rendements. Le Royaume-Uni, après une décennie de baisse, affiche un retour en force, retrouvant des niveaux d’importation pré-Brexit. Cependant, ce succès à l’export masque une situation tendue sur le marché national. Les Français consomment moins de pommes de terre, avec une baisse de 4,2 % des volumes achetés en raison de l’inflation. Les prix au kilo ont augmenté de près de 10 %, incitant les consommateurs à préférer les formats plus petits. Cette réduction de la consommation frappe particulièrement les magasins de proximité et les primeurs.
Malgré ce contexte, l’élan des exportations montre le potentiel de la filière française, qui continue d’être une locomotive pour l’agriculture nationale. Le défi réside désormais dans la capacité à stabiliser les prix et à maintenir cet équilibre entre le marché domestique et les débouchés internationaux. Par ailleurs, des investissements dans l’innovation et une amélioration des infrastructures pourraient jouer un rôle clé dans le maintien de cette dynamique positive.
Les Echos, De la bière des vagabonds à la bière de la « street culture » : la success-story de la 8.6, 02/01/2025
La marque néerlandaise 8.6, autrefois associée à une consommation marginale, a réussi à se transformer en une référence de la « street culture » grâce à une stratégie marketing audacieuse. En 2024, ses volumes de ventes ont augmenté de 11 % en France, son principal marché, malgré un recul global de 3 % du marché de la bière. Ce résultat remarquable est le fruit d’une image renouvelée et d’une forte présence dans des événements culturels et artistiques.
L’intégration de la 8.6 dans l’univers du tatouage, du street art et des festivals a permis à la marque de réconcilier son identité avec une clientèle plus large. En misant sur des collaborations avec plus de 200 artistes et en participant à des festivals comme Rock en Seine ou Garorock, la 8.6 a su redéfinir son positionnement. Cette transformation s’est accompagnée d’une hausse des investissements marketing, notamment en digital, affichage et radio, pour capter l’attention d’une génération connectée.
La marque a aussi misé sur l’innovation avec une gamme diversifiée : bières fruitées, IPA, et dernièrement une version à la cerise. Ces choix audacieux ont été complétés par l’ouverture de nouveaux canaux de distribution, comme les boulangeries, la restauration rapide et récemment les bars, autrefois inaccessibles. Aujourd’hui, la 8.6 domine le segment des bières en canettes de 50 cl. Avec un chiffre d’affaires en hausse de 11 % et des ventes qui ont atteint 900 000 hectolitres en 2024, la 8.6 symbolise la capacité d’une marque à se réinventer et à prospérer dans un marché en mutation.
Les Échos, Les boulangeries Feuillette prennent le contre-pied des coffee-shops à l'américaine, 02/01/2025
L’enseigne Feuillette, connue pour ses boulangeries artisanales, s’engage dans une stratégie de diversification ambitieuse en introduisant les Cafés Feuillette. Ces nouveaux espaces, conçus pour contrer les coffee-shops à l’américaine, proposent une offre authentiquement française. Avec une carte composée de madeleines, cannelés, et autres douceurs maison, ces cafés réinventent la pause gourmande. Le premier point de vente, situé à Tours, a rapidement dépassé les prévisions de fréquentation.
Parallèlement, Feuillette prévoit d’ouvrir 30 nouvelles boulangeries en 2025, renforçant sa position de troisième acteur du secteur derrière Marie Blachère et Ange. Avec un chiffre d’affaires de 210 millions d’euros et 2 500 salariés, l’entreprise mise sur l’expansion en franchise tout en maintenant un fort contrôle sur la qualité grâce à ses laboratoires centralisés. Ces installations, déjà agrandies, seront complétées par un second site pour accompagner cette croissance.
Feuillette explore également d’autres horizons, comme la restauration avec un concept inspiré des « bouillons » parisiens, et l’épicerie fine. De plus, l’enseigne prévoit une implantation aux États-Unis via une master franchise au Texas, marquant ainsi une étape clé dans son internationalisation.
Les Échos, Biocoop et Naturalia espèrent être sortis de « l'hiver du bio », 01/01/2025
Après deux années difficiles marquées par une forte inflation, le marché du bio semble amorcer une reprise. En 2024, Biocoop et Naturalia ont affiché des croissances respectives de 8 % et 5 %, portées par une hausse des paniers moyens et un retour des clients fidèles. Les circuits courts, avec une augmentation de 3 % des ventes en direct depuis les fermes, complètent cette tendance positive.
Cependant, la grande distribution continue de supprimer des références bio, entrainant une baisse de 5 % des ventes sur ce canal. En réaction, les consommateurs se tournent vers les enseignes spécialisées, où l’offre reste diversifiée et qualitative. Cette évolution souligne un transfert progressif des parts de marché, mais laisse planer des incertitudes pour les producteurs. L’élevage bio, notamment, souffre de la baisse de la demande en viande, contraignant de nombreux exploitants à vendre au prix du conventionnel.
Pour consolider cette reprise, l’Agence BIO intensifie ses efforts dans la restauration hors foyer. Une campagne de sensibilisation, appuyée par des subventions européennes, vise à intégrer davantage de produits bio dans les cantines et restaurants gastronomiques. Parallèlement, des actions éducatives cherchent à sensibiliser le public sur les bienfaits d’une consommation bio et locale. Bien que les défis restent nombreux, cette stratégie pourrait offrir des opportunités à une filière en quête de stabilité et encourager un renouveau durable du secteur.
Le Monde, Le sarrasin, petite graine aux grandes vertus, 09/01/2025
Le sarrasin revient en force dans les cuisines françaises. Avec seulement 0,4 % des surfaces cultivées en France, cette plante rustique, aussi appelée « blé noir », s’impose comme une alternative durable et nutritive. Des chefs comme Manon Fleury réinvente le sarrasin dans des plats contemporains, explorant ses arômes de noisette et ses propriétés digestives.
Outre les galettes bretonnes, le sarrasin s’invite dans des granolas, thés et desserts à base de graines torréfiées. Les entreprises bretonnes, notamment dans le Morbihan, innovent également avec des produits comme les caramels et soupes enrichies en sarrasin. L’essor de cette graine répond à une demande croissante pour des aliments locaux et sains. De plus, des initiatives comme la Fête du sarrasin sensibilisent le public à ses vertus tout en soutenant une agriculture régionale plus durable.
Sur le plan économique, les efforts pour produire un sarrasin entièrement français portent leurs fruits. Alors que l’importation représentait autrefois 70 % de la consommation nationale, ce chiffre est désormais réduit à 30 %, grâce à des projets de réintroduction menés par des acteurs locaux. Le sarrasin, emblème de la gastronomie bretonne, se transforme ainsi en un produit phare, à la croisée des enjeux de durabilité et d’innovation culinaire.
Le Monde, Le « Dubai Chocolate », de l’or en barres, 01/01/2025
Le phénomène du « Dubai Chocolate » illustre une nouvelle tendance mondiale où les confiseries exclusives deviennent des symboles de statut et de culture. Cette tablette de chocolat, conçue par la chocolaterie Fix basée à Dubaï, attire l’attention pour son design inspiré de l’expressionnisme abstrait et son fourrage original mêlant crème de pistache, tahin et cheveux d’ange grillés. Baptisée « Can’t Get Knafeh of It », elle s’inspire du dessert traditionnel levantin, le knafeh.
Fabriqué en quantités limitées, ce chocolat est vendu à des prix exorbitants. À l’origine fixé à 25 dollars par tablette, il atteint des centaines d’euros sur les plateformes de revente. Son succès est largement alimenté par les réseaux sociaux, notamment TikTok, où le hashtag « Dubai Chocolate » a accumulé plus de 500 millions d’interactions. Une vidéo virale de dégustation, vue plus de 100 millions de fois, a propulsé la friandise au rang d’icône numérique.
Cependant, cette popularité a engendré des phénomènes de contrefaçon et même des cas de contrebande, notamment à la frontière entre la Suisse et l’Allemagne. Face à la demande croissante, des chocolatiers européens proposent des alternatives plus abordables, bien que l’original conserve son aura de luxe.
Au-delà de l’aspect commercial, le « Dubai Chocolate » incarne un outil de soft power pour les Émirats arabes unis. Le produit est devenu un symbole de la créativité et de l’excellence dubaïotes, contribuant à l’image moderne de l’émirat.
Le Monde, De New York à Tulum, les pâtissiers français expriment leur créativité à l’étranger, 25/12/2024
La pâtisserie française s’exporte avec succès dans le monde entier, portée par des chefs audacieux. À Tulum, le chef Antonin Simon réinvente les classiques français en y intégrant des saveurs locales comme l’horchata ou le miel maya. Ce processus d’adaptation, nécessitant une maîtrise des ingrédients et des conditions locales, souligne la capacité des pâtissiers français à s’adapter sans compromettre la qualité.Aux États-Unis, Eunji Lee, fondatrice de la pâtisserie Lysée à New York, mêle influences françaises, coréennes et américaines. Ses créations comme le Paris-Brest revisité ou sa galette des rois sans fève traduisent un dialogue culinaire entre tradition et modernité. Yann Couvreur, quant à lui, conserve ses recettes classiques tout en adaptant ses ingrédients aux spécificités locales et aux saisons, que ce soit à Miami, Séoul ou Riyad.
Ces expériences mettent en lumière la manière dont la pâtisserie française s’impose comme un langage universel. Loin de simplement exporter des recettes, ces chefs incarnent un échange culturel riche, où l’innovation rencontre le respect des terroirs locaux. Ce mouvement contribue non seulement au rayonnement de la gastronomie française, mais aussi à l’enrichissement des patrimoines culinaires mondiaux.
Ce développement témoigne d'une dynamique qui dépasse l'aspect purement commercial, mettant en avant des valeurs d'excellence et d'authenticité. En intégrant les spécificités locales tout en préservant leurs racines, ces chefs bâtissent un pont entre les cultures et renforcent l’image de la pâtisserie française comme référence mondiale. Les collaborations avec des producteurs locaux et l'enseignement des techniques pâtissières aux équipes étrangères enrichissent également les échanges, consolidant un écosystème mondial où la gastronomie devient un langage universel.
Libération, Vanille locale, cookie au foin, galette des rois à la tagète… La pâtisserie écolo veut faire sa part, 10/01/2025
À Rennes, Marion Juhel, fondatrice de la pâtisserie Seize heures trente, redéfinit les codes de la pâtisserie en mêlant plaisir, tradition et durabilité. Cette ancienne ingénieure a quitté son métier pour se consacrer à sa passion et développer un modèle de pâtisserie écoresponsable. Ses créations, des classiques comme les cakes, financiers et cannelés, sont élaborées à partir de produits locaux et de saison : farine de sarrasin, beurre artisanal ou fruits des maraîchers environnants. Chaque étape du processus, de la conception à la livraison en vélo-cargo, reflète un engagement envers la réduction de l’empreinte écologique. Dans son laboratoire, rien n’est laissé au hasard. Les déchets alimentaires sont réduits grâce à des techniques comme la déshydratation des pelures de fruits pour aromatiser d’autres préparations. Les viennoiseries non vendues deviennent pudding, et un seul type de boîte recyclable est utilisé pour les pâtisseries, optimisant la gestion des emballages. Cette démarche, combinant sobriété et innovation, permet à Marion Juhel de se distinguer, notamment avec des créations uniques comme le flan vertical « warung », qui rappelle une tranche de pâté en croûte.
Elle n’est pas seule dans cette quête de durabilité. À Paris, des pâtissiers comme Sabrina Allard (pâtisserie Mélilot) et Emma Duvéré adoptent des démarches similaires, intégrant des ingrédients locaux comme le mélilot ou collaborant avec des fournisseurs éthiques pour le chocolat. À Grenoble et Mougins, d’autres artisans explorent des saveurs régionales tout en bannissant les plastiques à usage unique et en optimisant les outils de travail.Cependant, le chemin reste semé d’embûches. Le coût des matières premières biologiques et locales est un défi majeur, forçant les pâtissiers à ajuster leurs prix ou à diversifier leurs offres pour équilibrer leurs finances. De plus, éduquer les consommateurs habitués à des produits standards et disponibles toute l’année demande tact et pédagogie.
Malgré ces obstacles, l’essor de la pâtisserie durable est prometteur. Le récent concours de pâtisserie durable, remporté par Baptiste Blanc, illustre l’intérêt croissant pour des pratiques plus respectueuses de l’environnement. Avec des initiatives comme celles de Marion Juhel et d’autres pionniers, la pâtisserie écolo prouve qu’elle peut marier gourmandise, éthique et créativité.
Le Figaro, Qu’allons-nous manger en 2025 ?, 03/01/2025
L’alimentation de demain évolue sous l’influence de tendances globales telles que la durabilité, la technologie et la santé. En 2025, plusieurs changements marqueront les habitudes alimentaires, avec une augmentation significative de la consommation de protéines alternatives, notamment les insectes, les algues et les viandes cultivées en laboratoire. Ces innovations répondent à la fois aux préoccupations écologiques et au besoin de diversifier les sources de protéines pour une population mondiale croissante.
Le développement technologique joue également un rôle clé, avec l’essor des cuisines connectées et des applications d’aide à la préparation des repas. Les consommateurs utilisent de plus en plus des outils intelligents pour optimiser leurs achats et cuisiner des plats équilibrés. Les imprimantes alimentaires 3D, bien qu’encore marginales, pourraient également transformer la manière de concevoir les repas en permettant de personnaliser textures et goûts.
Parallèlement, la santé reste au cœur des préoccupations. Les aliments fonctionnels, enrichis en nutriments spécifiques pour prévenir certaines maladies, gagneront en popularité. Les consommateurs cherchent aussi des produits transparents, traçables et exempts de substances controversées. Le « clean label », garantissant une composition claire et naturelle, deviendra un standard pour les marques souhaitant conserver la confiance de leurs clients.
L’alimentation durable s’imposera comme une priorité. Les circuits courts, la réduction du gaspillage et l’utilisation de packaging biodégradable seront des éléments centraux des stratégies des entreprises. Le rôle des gouvernements sera également crucial pour encourager les pratiques agricoles responsables et soutenir la transition vers une économie alimentaire plus verte.
Ainsi, la nourriture en 2025 sera un mélange de tradition et d’innovation, avec un fort accent sur la durabilité et le bien-être. Ces évolutions nécessitent un changement profond des mentalités et des infrastructures, mais elles ouvrent également la voie à une alimentation plus respectueuse de l’environnement et adaptée aux défis du futur.
RFI, Le prosecco, un vin traditionnel devenu un symbole de l’excellence italienne, 23/12/2024
Le prosecco, vin pétillant originaire de Vénétie, connaît un essor fulgurant et s’impose aujourd’hui comme un symbole de l’excellence italienne. En 2024, les exportations ont dépassé les 800 millions de bouteilles, confirmant la popularité grandissante de ce produit. Contrairement au champagne, souvent associé à des célébrations luxueuses, le prosecco séduit par son accessibilité et sa polyvalence, devenant une boisson de choix pour des occasions variées.
Son succès repose sur plusieurs facteurs clés : un prix compétitif, une teneur en alcool modérée et des saveurs fruitées qui plaisent à un large public. Les campagnes de promotion orchestrées par les consortiums viticoles ont également joué un rôle crucial, valorisant les terroirs et les traditions italiennes. Par ailleurs, les appellations DOC et DOCG, garantes de qualité, ont renforcé la confiance des consommateurs à travers le monde.
Cependant, cet engouement s’accompagne de défis. La forte demande internationale exerce une pression sur les producteurs, qui doivent concilier expansion et préservation de la qualité. Les préoccupations environnementales liées à l’intensification de la culture de la vigne se font également de plus en plus entendre. Pour y répondre, les acteurs de la filière explorent des pratiques plus durables, comme l’agriculture biologique et la réduction des intrants chimiques.
En dépit de ces défis, le prosecco continue de conquérir de nouveaux marchés, notamment en Asie et en Amérique du Nord, tout en maintenant sa popularité en Europe. Il incarne la capacité de l’Italie à marier tradition et innovation, consolidant sa position en tant que leader mondial des vins pétillants.
L’Usine Nouvelle, Huile d’olive, jusqu’où ira la Turquie ?, 25/12/2024
La Turquie se distingue cette année comme un acteur majeur sur le marché mondial de l’huile d’olive avec une production record de 420 000 tonnes pour la saison 2023-2024. Ce succès découle de plusieurs facteurs : des conditions climatiques particulièrement favorables, des politiques gouvernementales incitatives et des investissements massifs dans la modernisation des infrastructures oléicoles. Ce positionnement fait de la Turquie le deuxième exportateur mondial, dépassant des acteurs traditionnels comme l’Italie et la Grèce, et consolidant sa présence sur les marchés européens et américains.
Les stratégies turques incluent la valorisation des appellations locales, telles que la "Riviera Zeytinyağı", et un accent sur les huiles extra-vierges de haute qualité. Ces efforts ont porté leurs fruits, comme en témoigne la reconnaissance obtenue lors de concours internationaux. Cependant, cette expansion rapide n’est pas sans défi. L’intensification des cultures pose des questions sur la durabilité écologique, tandis que la forte compétitivité des prix internationaux met une pression constante sur les marges des producteurs. Par ailleurs, la montée des marques turques sur les étagères des supermarchés européens reflète une stratégie marketing ciblée, mais aussi une réponse à la demande croissante pour des alternatives de qualité à des prix abordables. Alors que la Turquie ambitionne d’augmenter sa production pour atteindre le demi-million de tonnes d’ici 2026, elle devra également s’adapter à un contexte mondial marqué par la variabilité climatique et l’évolution des préférences des consommateurs. Ce tournant pourrait faire de la Turquie un leader incontournable dans l’oléiculture mondiale.
Le Figaro, À Bordeaux, un mystérieux vin à la vanille produit par un château de Saint-Émilion, 18/12/2024
Le château La Fleur Morange, un grand cru classé de Saint-Émilion, surprend en lançant deux cuvées innovantes de vin blanc à la vanille de Tahiti. Ces créations, baptisées Te Ata et Te Hono, combinent la tradition viticole bordelaise avec les arômes exotiques de la vanille tahitienne. Te Ata, léger et explosif en fin de bouche, s’accorde avec la cuisine tahitienne, tandis que Te Hono, contenant un bâtonnet de vanille dans la bouteille, offre des notes tanniques plus prononcées et se prête à des cocktails ou des accords culinaires audacieux.
L’idée est née d’une rencontre fortuite entre les propriétaires du château et des producteurs polynésiens de vanille. Séduits par cette opportunité, Jean-François Julien, copropriétaire du domaine, a vu dans cette collaboration un parallèle entre la finesse du terroir viticole et celle de la production de vanille. Cette initiative s’inscrit dans une démarche d’innovation constante, caractéristique du domaine familial.
Destinées initialement à la Polynésie, les 3 000 premières bouteilles commercialisées en novembre 2024 ont été rapidement écoulées. Le vin s’adapte parfaitement à la cuisine locale, comblant une demande pour des produits uniques en accord avec la gastronomie tahitienne. Pour l’instant, ces cuvées ne sont pas disponibles en France ni en Europe, le château privilégiant un développement progressif sur le marché polynésien.
Loin d’être une simple curiosité, ce projet vise à marier deux produits d’exception : un vin de luxe et une vanille haut de gamme. Jean-François Julien insiste sur l’importance de la qualité dans cette innovation, démontrant que les Bordelais peuvent également exceller dans des créations exotiques. Si l’expérience en Polynésie se confirme, ces vins pourraient un jour séduire un public européen, renforçant ainsi l’image d’un vignoble bordelais audacieux et ouvert à de nouvelles perspectives.
Wall Street Journal, Does French Flour Make Better, Healthier Bread, or Is It Just Hype?, 07/01/2025
Les consommateurs américains montrent un engouement croissant pour la farine française, souvent perçue comme un produit de qualité supérieure grâce à ses propriétés uniques et son rôle dans la préparation de pains et pâtisseries artisanaux. Cet intérêt a été stimulé par la montée de la boulangerie maison, notamment après la pandémie de COVID-19, ainsi que par le succès des boulangeries artisanales aux États-Unis qui mettent en avant l’authenticité des ingrédients français.
Les meuniers français, reconnus pour leur savoir-faire, exportent désormais des farines spécifiques adaptées aux besoins des consommateurs américains, qu’il s’agisse de baguettes croustillantes ou de croissants feuilletés. Cette collaboration avec des artisans locaux a permis d’établir un pont culturel entre les deux pays, tout en renforçant la reconnaissance internationale de la farine française.
Cependant, les défis ne manquent pas. Les coûts d'importation élevés, exacerbés par les fluctuations des devises et les tensions commerciales, posent des difficultés. En réponse, certains acteurs du secteur envisagent des partenariats locaux pour produire des farines de style français directement sur le sol américain, tout en conservant les standards de qualité.
La reconnaissance de la farine française sur le marché américain représente une opportunité économique pour les exportateurs et une manière de valoriser le patrimoine culinaire français.
Slate, All Aboard the Fruit Tourism Train, 26/12/2024
Le tourisme fruitier, une niche en pleine expansion, attire un nombre croissant de visiteurs désireux de découvrir les vergers et les régions agricoles spécialisées dans les fruits. Cette tendance reflète un intérêt grandissant pour l’agritourisme et la reconnexion avec la nature, offrant une expérience immersive aux amateurs de produits frais et locaux. Des destinations comme la Californie, avec ses vignobles de raisins de table, ou les vergers de pommes de l’État de Washington, sont devenues des étapes incontournables pour les touristes. Ces visites incluent souvent des dégustations, des ateliers de cueillette et des démonstrations de transformation artisanale, créant une opportunité d’apprentissage ludique autour des fruits. En Europe, des pays comme la France et l’Italie se positionnent également sur ce créneau, en mettant en avant des traditions locales et des produits d’exception. Par exemple, la Provence attire les visiteurs avec ses figuiers et ses spécialités de confitures artisanales, tandis que l’Italie propose des circuits autour des agrumes de Sicile.
Le développement de ce type de tourisme pose néanmoins des défis logistiques et environnementaux. Il est essentiel pour les producteurs d’équilibrer l’afflux de visiteurs avec la protection des cultures et la préservation des écosystèmes locaux. En parallèle, les professionnels du secteur doivent diversifier leur offre pour rester attractifs face à une concurrence croissante.
Le tourisme fruitier incarne une nouvelle forme de consommation responsable et culturelle, où l’expérience et l’authenticité priment sur le simple achat de produits. En reliant les consommateurs aux agriculteurs et en valorisant les circuits courts, ce modèle contribue également à soutenir l’économie locale tout en sensibilisant le public aux enjeux de l’agriculture durable.
The Guardian, Is pistachio the new pumpkin spice? Why production of the nut is booming in California, 03/01/2025
La pistache connaît un essor sans précédent et devient un produit phare sur le marché mondial. Son succès repose sur sa polyvalence culinaire et ses bienfaits pour la santé. Riche en protéines, fibres et antioxydants, elle est prisée pour ses qualités nutritionnelles et son rôle dans les régimes équilibrés. La demande croissante pour des snacks sains et des ingrédients de qualité premium stimule sa consommation dans des secteurs variés, allant des desserts aux plats salés.
Les principaux producteurs, comme l’Iran, les États-Unis et la Turquie, augmentent leur capacité pour répondre à cette popularité croissante. Cependant, cette expansion pose des défis écologiques. La culture des pistachiers nécessite beaucoup d’eau, ce qui exacerbe les tensions dans les régions frappées par la sécheresse. Des innovations agricoles, comme l’irrigation goutte-à-goutte, sont mises en œuvre pour minimiser l’impact environnemental.
La pistache est également devenue un ingrédient incontournable dans les tendances gastronomiques, des crèmes glacées aux sauces en passant par les pâtisseries haut de gamme. Ce succès reflète une évolution des attentes des consommateurs, qui cherchent des produits alliant plaisir gustatif, santé et responsabilité écologique. La pistache s’impose ainsi comme la noix de l’avenir, répondant aux enjeux de durabilité et d’innovation.
Fast Company, Morning coffee tied to lower death risk, 08/01/2025
Une étude récente met en lumière les bienfaits potentiels du café sur la santé et révèle qu’une consommation régulière de café pourrait réduire les risques de mortalité prématurée. Publiée dans un journal médical de renom, cette recherche s’appuie sur une analyse de données provenant de plus de 500 000 participants sur une période de 10 ans. Elle montre que les consommateurs de café, en particulier ceux qui optent pour une préparation sans sucre ajouté, bénéficient de taux réduits de maladies cardiovasculaires et de certains cancers.
Le café, riche en antioxydants et en composés bioactifs, pourrait jouer un rôle protecteur contre l’inflammation chronique et les dommages cellulaires. Les chercheurs notent que les bienfaits sont similaires pour le café avec ou sans caféine, suggérant que ce ne sont pas uniquement les effets stimulants qui contribuent à ces résultats positifs. Cependant, ils mettent en garde contre une surconsommation, qui peut entraîner des effets indésirables tels que l’anxiété ou des troubles du sommeil.
En parallèle, l’étude explore les différences entre les méthodes de préparation, comme le café filtre, l’espresso ou les capsules, et leurs impacts respectifs sur la santé. Les résultats indiquent que les méthodes de filtration pourraient être légèrement plus bénéfiques, en raison de leur capacité à réduire certains composés nocifs présents dans le marc de café.
Cette étude alimente le débat sur l’impact des habitudes alimentaires sur la longévité et renforce le rôle du café comme élément potentiellement bénéfique d’un mode de vie équilibré. Elle ouvre également des perspectives pour les marques de café, qui peuvent mettre en avant ces résultats dans leurs stratégies de communication, tout en sensibilisant à une consommation modérée et responsable. Le café continue ainsi de s’imposer comme une boisson universelle, appréciée autant pour son goût que pour ses potentielles vertus pour la santé.
Los Angeles Times, Why the U.S. surgeon general wants cancer warning labels on alcoholic drinks, 03/01/2025
La proposition du Surgeon General des États-Unis (le principal porte-parole du gouvernement fédéral des États-Unis pour les questions de santé publique) d’ajouter des avertissements sur les risques de cancer sur les boissons alcoolisées suscite un débat national. Actuellement, les étiquettes des boissons alcoolisées mettent principalement en garde contre les dangers pour les femmes enceintes et les risques liés à la conduite sous influence. Toutefois, des études récentes montrent que même une consommation modérée d’alcool est associée à un risque accru de plusieurs types de cancer, notamment ceux du sein, du foie et du côlon.
Cette initiative s’appuie sur des recherches menées par des institutions comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui classe l’alcool parmi les cancérogènes. L’objectif des nouvelles étiquettes serait d’éduquer les consommateurs sur ces dangers, dans l’espoir de réduire la consommation d’alcool et, par extension, les cas de cancers évitables. De telles mesures ont déjà été mises en œuvre avec succès dans d’autres pays, notamment au Canada, où les étiquettes explicites sur l’alcool ont conduit à une baisse de la consommation.
Les partisans de cette mesure affirment que l’industrie de l’alcool bénéficie d’une réglementation plus laxiste que celle appliquée au tabac, malgré des risques sanitaires comparables. Ils dénoncent également le lobbying exercé par les grands groupes de l’industrie pour minimiser les effets nocifs de l’alcool. En revanche, les opposants, notamment les représentants de l’industrie, craignent que ces avertissements nuisent aux ventes et à l’image des produits. Ils remettent également en question l’efficacité de telles étiquettes pour influencer les comportements des consommateurs.
Si cette proposition est adoptée, elle pourrait ouvrir la voie à des réglementations plus strictes sur la publicité et la commercialisation de l’alcool. Cependant, son impact dépendra de la capacité des autorités à surmonter les résistances de l’industrie et à sensibiliser efficacement le public. Dans un pays où la consommation d’alcool est culturellement ancrée, cette initiative représente un défi majeur pour la santé publique.
Forbes, Generation Beta—Why 2025 Marks The Beginning Of A New Food Generation, 02/01/2025
La « Génération Bêta », qui regroupe les individus nés après 2010, redéfinit les standards de l’industrie agroalimentaire. Sensibilisés dès leur jeune âge aux enjeux environnementaux et sociaux, ces consommateurs adoptent des comportements alimentaires qui privilégient la durabilité, la transparence et la personnalisation.
Cette génération exige des marques qu’elles s’engagent dans des pratiques responsables, de la production à la distribution. Les aliments biologiques, les emballages compostables et les initiatives pour réduire le gaspillage alimentaire sont devenus des attentes minimales. De plus, les technologies jouent un rôle central : les applications mobiles, les systèmes de traçabilité et l’intelligence artificielle transforment la manière dont cette génération interagit avec l’alimentation.
Les experts prévoient que la Génération Bêta influencera profondément le marché à partir de 2025, obligeant les entreprises à repenser leurs produits et leurs stratégies. Ce changement pourrait marquer le début d’une ère où les préférences des jeunes consommateurs dicteront les tendances alimentaires mondiales.
Punchdrink, The New Vocabulary of Nonalcoholic Drinks, 10/01/2025
L’univers des boissons non alcoolisées (N/A) connaît une croissance fulgurante outre-Atlantique, accompagnée d’un vocabulaire en constante évolution pour décrire ce secteur en plein essor. Contrairement aux catégories d’alcool définies par des critères légaux stricts, les boissons non alcoolisées restent difficiles à encadrer, oscillant entre innovation, fonction sociale et expérimentation. Cette ambiguïté nourrit un débat sur leur définition : sont-elles simplement des alternatives à l’alcool ou des boissons autonomes avec leur propre identité ?
Des termes comme “spirit-free”, “zero-proof” ou encore “ANA” (adult nonalcoholic beverage) reflètent cette quête d’identité. Les boissons N/A sont souvent décrites en opposition à l’alcool, mais l’accent est désormais mis sur leur complexité gustative, avec des saveurs comme le houblon, le fumé ou le botanique. De plus, des catégories émergentes comme les “blends” (mélanges de fruits, thés et épices) ou les “adaptogens” (plantes supposées réduire le stress) enrichissent l’offre.
Les innovations incluent également des produits fonctionnels qui ne se contentent pas d’hydrater, mais promettent des effets cognitifs ou apaisants grâce à des “nootropics” (ex. : caféine, GABA) ou des infusions spécifiques, telles que le kava, réputé pour ses effets relaxants. La montée en popularité des boissons infusées au THC, appelées “canna bevs”, témoigne également de l’élargissement des frontières de cette catégorie.
De nouveaux comportements de consommation émergent également, tels que le “zebra striping” (alterner boissons alcoolisées et non alcoolisées) ou le “damp drinking”, qui prône une réduction consciente de l’alcool sans abstinence totale. Ces pratiques reflètent une approche plus équilibrée et consciente du plaisir de boire.
Les fabricants se tournent vers des techniques comme la “dealcoholization” (retrait de l’alcool d’un produit) ou la création d’analogues de spiritueux classiques pour répondre à une demande croissante. Cependant, l’objectif dépasse la simple imitation : il s’agit de créer une expérience distincte et raffinée, capable de rivaliser avec les boissons alcoolisées.
On finit cette première newsletter de l’année avec le fameux burger de Maïté
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A la semaine prochaine!
O. Frey