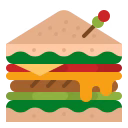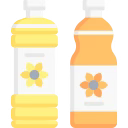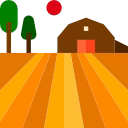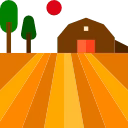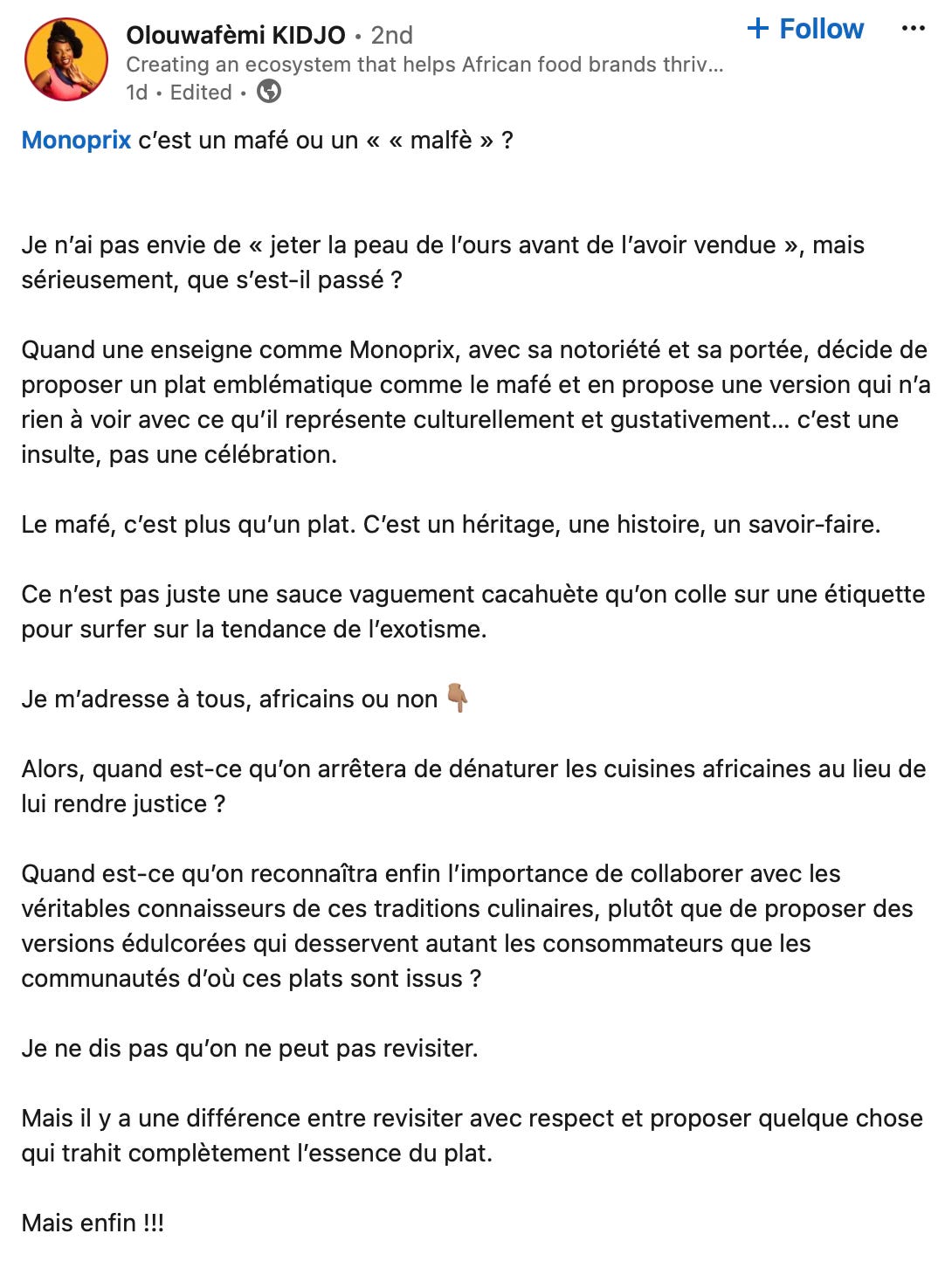🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2024-35
Bonjour à toutes et à tous, Eat's Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.
Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :
Les Échos, AOP, IGP : la difficile adaptation des produits labellisés au changement climatique, 26/11/2024
Les Échos, Le café flambe et le monde regarde ailleurs, 25/11/2024
New York Times, Taxing Farm Animals’ Farts and Burps? Denmark Gives It a Try, 26/11/2024
Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!
Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :
Libération, La Liste consacre (encore) Guy Savoy et révèle les tendances food mondiales, 25/11/2024
La Liste, célèbre classement des 1 000 meilleurs restaurants au monde, a publié son édition 2024, confirmant la place de Guy Savoy parmi l’élite au côté de huit autres établissements internationaux. Ce palmarès, basé sur un algorithme croisant critiques et avis en ligne, reflète à la fois la constance des grandes adresses et l’évolution des courants culinaires mondiaux. L’édition 2024 met en lumière des tendances marquantes. La fermentation et la cuisson au feu de bois reviennent en force, incarnant un retour aux traditions ancestrales. À Paris, des adresses comme Ardent ou la Brasserie Dubillot adoptent ces techniques pour offrir une expérience immersive et chaleureuse. Parallèlement, le végétal poursuit son essor, bien au-delà des tables étoilées, affirmant son ancrage dans les préoccupations environnementales et éthiques. Le rapport souligne également la montée en gamme du sushi, désormais perçu comme un art culinaire raffiné, tandis que la cuisine coréenne s’impose comme une gastronomie d’avenir, portée par l’influence culturelle des séries et films sud-coréens. En Inde, une révolution discrète mais significative voit émerger des restaurants ambitieux, valorisant la diversité des traditions régionales.
Cependant, la gastronomie mondiale traverse une période délicate. La hausse des coûts énergétiques, la pénurie de personnel et l’inflation pèsent lourdement sur les établissements, en particulier les indépendants. Des fermetures en chaîne sont signalées au Royaume-Uni, en Espagne et même en Italie, comme en témoigne le cas emblématique du restaurant de Carlo Cracco à Milan, qui a accumulé 4,6 millions d’euros de pertes. Dans ce contexte, les grands groupes de luxe et hôteliers consolident leur domination, creusant un écart avec les petites structures. En réponse, certains chefs adoptent des approches plus conviviales et accessibles. À Berlin, le restaurant Nobelhart & Schmutzig a par exemple réduit ses prix de 40 % en proposant des plats simples comme le schnitzel et en recentrant l’expérience sur le plaisir du convive.
Face aux défis économiques, une tendance émerge : la réinvention de la gastronomie autour de l’humain. Plutôt que d’imposer des concepts rigides, les restaurants qui prospèrent placent leurs clients au cœur de leur démarche. La Liste illustre ainsi une transition vers une cuisine généreuse et accessible, renouant avec l’essence du partage et du plaisir. Une possible résurgence de la cucina povera ? L’avenir le dira.
Libération, Du palmarès du «Fooding» au guide Pudlo, de timides lueurs d’espoir pour les femmes dans la gastronomie, 19/11/2024
C’est malheureusement une vieille rengaine. Mais force est de constater que les femmes continuent de briller par leur absence dans les grands palmarès gastronomiques, comme l’a une nouvelle fois illustré la cérémonie du Gault et Millau 2025. Dévoilé le 18 novembre dernier, le prestigieux guide a, une fois de plus, mis les hommes à l’honneur : cuisinier de l’année, sommeliers, grands de demain… Seule une femme, Margaux Le Baillif, a été distinguée, et encore, en binôme avec Brice Goeuriot pour leur restaurant Nuance à Bayonne. Cette quasi-exclusion des cheffes et sommelières alimente un constat récurrent : dans les cercles de la critique gastronomique traditionnelle, la reconnaissance du talent reste largement associée au masculin.
Cependant, d’autres remises de prix organisées le même jour ont offert quelques lueurs d’espoir. À Limoges, lors du premier championnat du monde de chou farci, c’est Bernadette De Rozario, venue de Singapour, qui a triomphé face à quatre hommes. Jeune et déjà saluée pour son savoir-faire, elle incarne un souffle nouveau dans un univers encore dominé par les hommes.
De son côté, le guide Fooding, connu pour son approche décalée de la critique culinaire, a également donné davantage de visibilité aux femmes. Sur les 17 catégories de prix décernés lors de sa cérémonie au Centre Pompidou, cinq récompensent des établissements dirigés par des femmes, seules ou en binôme. Parmi elles, Emmanuelle Lachaud (Flores, Gard) ou Mahaut Le Lagadec (Café Enez, Finistère) illustrent une volonté de renouveler les modèles de la gastronomie traditionnelle. Si les chiffres restent inégaux — 10 femmes contre 17 hommes récompensés —, le Fooding confirme son rôle d’acteur de changement en valorisant une cuisine plus moderne et accessible.
Enfin, le guide Pudlo, pourtant ancré dans une tradition plus classique, a lui aussi marqué des points. Avec deux femmes récompensées sur sept prix : Victoria Boller (Aux Lyonnais, Paris) et Anne-Cécile Faye (le Sancerre, Paris). Ces distinctions rappellent que le talent n’a pas de genre et que les mentalités évoluent, lentement mais sûrement.
L’Usine Nouvelle, Sassy fête dix ans de renouveau du cidre et du calvados, 24/11/2024
En une décennie, la PME Sassy a su moderniser l’image du cidre et du calvados, deux produits emblématiques de la Normandie. Fondée en 2014 par Pierre-Emmanuel Racine-Jourdren et Xavier d’Audiffret-Pasquier, cette entreprise normande a pris le pari de renouveler ces boissons en misant sur des circuits de distribution innovants et une approche premium.
Alors que le cidre traditionnel est souvent limité à une consommation saisonnière en France, les deux cofondateurs ont souhaité casser les codes. Travaillant le packaging pour le rendre plus moderne et les recettes pour séduire un public élargi, Sassy a privilégié des lieux branchés et haut de gamme, à l’instar du magasin parisien Colette ou des tables prestigieuses comme le Plaza Athénée. Ce positionnement novateur s’est rapidement révélé payant.
Sassy s’est aussi tournée vers le Royaume-Uni, l’un des plus gros marchés mondiaux du cidre. En 2016-2017, l’entreprise a ouvert une filiale à Londres, où Xavier d’Audiffret-Pasquier s’est installé pour développer des partenariats avec des bars à cocktails, des restaurants haut de gamme et des grands magasins. Cette stratégie a permis d’assurer une solide implantation, malgré les défis posés par le Brexit. Aujourd’hui, 50 % des ventes de Sassy sont réalisées outre-Manche.
La diversification de la gamme a également été une clé de leur succès. Pendant la crise sanitaire, l’entreprise a su rebondir en élargissant sa distribution aux grandes surfaces comme Monoprix et Carrefour. En 2021, Sassy a lancé un calvados en collaboration avec Nicolas Garnier, producteur dans l’Orne. Ce produit, retravaillé pour offrir des arômes plus ronds et accessibles, a marqué un nouveau tournant pour la marque. Dans la foulée, un cidre désalcoolisé et des jus de fruits ont enrichi l’offre, témoignant de la volonté de Sassy de répondre à une demande diversifiée. Les ventes de cidre désalcoolisé ont d’ailleurs progressé de 30 % entre 2023 et 2024. Malgré une conjoncture difficile marquée par l’inflation et des conditions climatiques complexes, Sassy prévoit une croissance de 15 % de son chiffre d’affaires en 2024. Aujourd’hui, l’entreprise emploie 15 personnes réparties entre la Normandie, Paris et Londres, et continue d’innover pour ancrer cidre et calvados dans les tendances de consommation actuelles.
Les Échos, AOP, IGP : la difficile adaptation des produits labellisés au changement climatique, 26/11/2024
Clémentines de Corse, roquefort, piment d’Espelette… Les produits labellisés AOP et IGP, emblèmes du terroir français, sont de plus en plus fragilisés par les bouleversements climatiques. Contraints par des cahiers des charges rigides et ancrés dans des territoires spécifiques, ces produits doivent concilier respect des traditions et nouvelles pratiques pour survivre.
Ces filières, qui représentent plus de 4 milliards d’euros en France selon l’Institut national de l’origine et de la qualité (Inao), subissent des aléas croissants : sécheresse, gel, pluies diluviennes. En 2022, la sécheresse a notamment réduit les récoltes, obligeant 78 filières à demander des dérogations temporaires à leurs règles de production. Le citron de Menton, par exemple, a vu une partie de sa récolte déclassée, ce qui a entraîné des pertes économiques importantes.
Face à cette réalité, les filières explorent des solutions pour maintenir la qualité et l’identité de leurs produits. La clémentine de Corse, affectée par des restrictions d’irrigation et une floraison décalée, perd en acidité. Pour y remédier, des tensiomètres ont été installés pour optimiser l’arrosage, et des protections naturelles comme le kaolin sont utilisées contre les insectes nuisibles. Le piment d’Espelette, victime des intempéries, expérimente des couverts végétaux pour protéger les plantations et envisage de décaler ses dates de culture. Ces mesures, inspirées de pratiques espagnoles, pourraient bientôt être intégrées à son cahier des charges. Le roquefort, première AOP française, doit, quant à lui, repenser l’alimentation de ses brebis face à la sécheresse qui réduit les pâturages en Aveyron. L’enrubannage des balles de foin, une méthode de conservation prolongée, devient une alternative essentielle pour maintenir la qualité du lait.
Ces ajustements, bien que nécessaires, s’accompagnent de défis économiques et organisationnels. Obtenir l’accord de l’Inao et des producteurs prend souvent des années, comme en témoigne l’exemple des ostréiculteurs de Marennes Oléron, qui ont attendu sept ans pour actualiser leurs règles. En parallèle, les consommateurs devront peut-être accepter de légères évolutions dans le goût ou l’apparence de ces produits iconiques. Entre innovations agricoles et sauvegarde du patrimoine, les filières AOP et IGP se trouvent à un tournant critique, où chaque adaptation représente une course contre le temps.
Les Échos, Le projet de surtaxe sur les boissons sucrées sème le trouble chez les industriels, 26/11/2024
L’industrie des boissons sans alcool (BRSA) est en ébullition après l’adoption par le Sénat d’une hausse significative de la fiscalité sur les boissons sucrées. Cette surtaxe, la troisième en douze ans, pourrait encore alourdir une taxe déjà fixée à 450 millions d’euros par an. Les députés avaient initialement voté une augmentation de 66 %, mais le Sénat a durci la mesure, prévoyant une hausse de 135 %. La Commission mixte paritaire (CMP) qui s’est réunie cette semaine a fini par adopter cette dernière proposition. Ainsi, il en coûtera 4 centimes par litre pour les breuvages les moins sucrés, et jusqu'à 35 centimes par litre pour les plus sucrés.
Si le gouvernement justifie cette initiative par des préoccupations sanitaires, les industriels dénoncent un manque de cohérence et un excès de pression fiscale. « Le modèle britannique, souvent cité en exemple, n’est pas adapté à la France, où une taxe existe déjà depuis douze ans et où la consommation est 30 % inférieure », souligne Inès Boulant, directrice générale du Syndicat des boissons sans alcool. Autre source de frustration : l’inclusion des édulcorants de synthèse dans la taxation, alors qu’ils sont exonérés outre-Manche. Pour le syndicat, cette décision ne vise qu’à générer des recettes supplémentaires pour l’État.
Les industriels rappellent les efforts déjà consentis ces quinze dernières années pour réduire la teneur en sucre des boissons. Selon l’Observatoire de l’alimentation (OQALI), la quantité de sucre a baissé de 7 % dans les BRSA, avec des réductions particulièrement marquées pour les colas (-31 %) et les eaux aromatisées (-25 %). Ce choix soulève donc des interrogations, d’autant que les volumes de ces boissons ne sont pas en forte croissance en France. En revanche, les thés glacés et eaux aromatisées, classés dans la tranche basse, ont vu leur marché se développer, tandis que les boissons énergisantes, très sucrées, ont doublé leurs ventes en cinq ans.
Le contexte économique et climatique complique encore la situation pour les producteurs. En 2024, le marché des boissons sans alcool a reculé de 3 % en volume et de 0,2 % en valeur, pénalisé par un printemps pluvieux et une météo capricieuse en été. Les prix des boissons sucrées ont, eux, bondi de 20,4 % sur l’année, aggravant une baisse de la demande. Si l’eau reste la catégorie la plus vendue avec 68 % des volumes, son chiffre d’affaires, bien inférieur, reflète des marges plus faibles.
Les Échos, Le café flambe et le monde regarde ailleurs, 25/11/2024
Le marché du café connaît une envolée des prix historique, notamment pour le robusta, qui atteint des sommets inégalés depuis 1979. Cette flambée illustre les pressions croissantes exercées par le changement climatique sur la filière. Avec une demande mondiale toujours en hausse, les producteurs peinent à maintenir leurs cultures, menacées par des conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles. Selon Andrea Illy, président d’Illy Caffè, si rien n’est fait, la moitié des terres cultivées aujourd’hui pourraient devenir inexploitables d’ici 2050.
Cette volatilité croissante des prix reflète les tensions entre une production affectée par les sécheresses et une demande qui favorise le robusta, plus abordable que l’arabica. Paradoxalement, cette situation profite à court terme à certains producteurs, mais elle souligne aussi la nécessité de réformes profondes dans la gestion des plantations. Des acteurs comme Illy ou Lavazza militent pour un modèle d’agriculture régénératrice visant à préserver la fertilité des sols et à adapter les plantations aux nouvelles réalités climatiques.
Face à ces défis, un Fonds mondial de soutien à la filière café a été lancé sous l’impulsion de l’Organisation internationale du café (OIC) et des pays du G7. Doté d’un objectif de 10 milliards d’euros sur dix ans, ce fonds public-privé ambitionne d’accompagner les producteurs dans la transition climatique et d’améliorer leurs conditions de vie. Les premiers projets pilotes se concentreront en Afrique, notamment en Éthiopie et au Kenya, avant d’être étendus à d’autres régions du monde.
Le réchauffement climatique redessine également la carte mondiale de la production de café. Si le Brésil reste le leader incontesté avec 40 % de la production, le Vietnam, champion du robusta, et des zones inattendues comme la Floride ou la Californie pourraient émerger comme nouveaux acteurs. Cependant, l’Afrique, berceau du café, pourrait jouer un rôle clé dans l’avenir, notamment grâce aux initiatives portées par l’Union européenne et des entreprises comme Illy et Lavazza.
Alors que la transition s’accélère, les petits producteurs, qui représentent les deux tiers de la production mondiale, font face à des défis considérables. Beaucoup vivent sous le seuil de pauvreté, rendant indispensable une aide ciblée pour les accompagner. Les discussions autour de régulations européennes, comme celles liées à la déforestation, ajoutent une pression supplémentaire, mais elles pourraient aussi être l’occasion de repenser le modèle global du café de manière plus durable. La filière, sous tension, est à un tournant décisif, entre résilience et innovation.
Le Monde, « Il y a sept-huit ans, une boulangerie sans beurre, sans œufs, sans lait, c’était difficile à concevoir, mais aujourd’hui c’est presque normal », 27/11/2024
Rodolphe Landemaine, fondateur des boulangeries Maison Landemaine et de l’enseigne végane Land & Monkeys, a transformé son parcours professionnel en véritable engagement pour une alimentation durable. Avec plus de 37 boulangeries en France et au Japon, cet entrepreneur normand a fait de sa vision une réalité : prouver qu’une boulangerie sans beurre, sans œufs ni lait peut séduire autant qu’une boulangerie traditionnelle.
Issu d’un milieu modeste en Normandie, Rodolphe Landemaine a choisi la boulangerie pour son potentiel économique. Après un apprentissage rigoureux en tant que compagnon du devoir et une expérience dans de prestigieux établissements, il ouvre en 2007 sa première boutique parisienne. En dix-sept ans, son groupe est passé de 7 à 700 employés. Mais en devenant végétalien il y a dix ans, il se retrouve confronté à un dilemme : continuer à diriger un groupe dépendant des produits d’origine animale ou tout abandonner. Il décide finalement de rester pour transformer l’industrie de l’intérieur.
Lancé en 2019, Land & Monkeys incarne cette ambition. Sa première boutique, boulevard Beaumarchais à Paris, triple son chiffre d’affaires dès la première année, encourageant l’ouverture de cinq autres établissements. Le concept repose sur des recettes végétales qui séduisent par leur goût, et non par leur étiquette. Parmi les créations phares, le sandwich Campagnard, qui revisite un classique français avec des légumes en lieu et place du pâté, illustre parfaitement cette philosophie.
Rodolphe Landemaine a également adopté une approche de triple comptabilité, évaluant ses performances économiques, sociales et environnementales, et fait de son groupe une entreprise à mission. Son objectif : démontrer qu’une alimentation végétale peut être rentable tout en réduisant l’empreinte carbone et en favorisant une alimentation plus durable à l’échelle planétaire.
Inc, The Makers of Phony Negroni Are on Track to Sell 2 Million Bottles This Year. How the Nonalcoholic Spirits Industry Is Coming of Age, 26/11/2024
Phony Negroni, un apéritif sans alcool lancé par St. Agrestis, est devenu l’un des symboles de la montée en puissance du marché des boissons sans alcool. Cette année, la marque new-yorkaise prévoit de vendre plus de deux millions de bouteilles, un chiffre impressionnant pour un produit qui a fait ses débuts en 2022. Fondée par Louis et Matt Catizone, ainsi que Steven DeAngelo, St. Agrestis s’est initialement concentrée sur la production de l’amaro, un spiritueux à base d’herbes ancré dans les traditions italiennes. Inspirés par le succès des boissons sans alcool en Europe, les fondateurs ont vu une opportunité de réinventer un cocktail classique pour une nouvelle génération de consommateurs.
Le Phony Negroni se distingue par son goût fidèle à l’original, une touche de carbonatation, et une composition complexe de 30 plantes botaniques issues de cinq continents. Conçu pour offrir une alternative crédible à ceux qui souhaitent réduire leur consommation d’alcool sans renoncer à l’expérience du cocktail, ce produit a bénéficié d’un contexte favorable. Les jeunes générations, notamment les Millennials et les Gen Z, se montrent de plus en plus enclines à modérer leur consommation d’alcool. Une étude publiée en 2020 dans JAMA Pediatricsa révélé une baisse de la consommation d’alcool chez ces groupes par rapport à leurs prédécesseurs.
Le succès du Phony Negroni s’inscrit dans un marché en pleine effervescence. Aux États-Unis, les boissons sans alcool ont enregistré une croissance annuelle de 30 % au cours des cinq dernières années, selon le cabinet IWSR. L’industrie attire désormais les conglomérats et investisseurs : Diageo a acquis Ritual Zero Proof, tandis que LVMH a investi dans French Bloom, un apéritif pétillant sans alcool vendu plus de 100 dollars la bouteille.
Pour se démarquer dans un secteur en expansion mais compétitif, St. Agrestis a misé sur une stratégie singulière. Contrairement à de nombreuses marques qui privilégient la vente directe au consommateur, St. Agrestis s’est d’abord implantée dans les bars et restaurants, où le Phony Negroni est proposé à des prix compris entre 10 et 15 dollars. Aujourd’hui, il est distribué dans environ 4 000 établissements et 1 000 points de vente au détail. Cette approche a permis d’augmenter les marges des restaurateurs, séduits par une alternative aux boissons alcoolisées qui ne se limite pas à de l’eau ou des sodas.
The Guardian, Chef-level fillings, queues down the street, big on TikTok: Britain’s new sandwich boom, 17/11/2024
Au Royaume-Uni, les sandwichs connaissent une véritable renaissance. Autrefois considérés comme des repas simples et économiques, ils sont aujourd’hui devenus des plats sophistiqués, à la croisée du fast-food et de la gastronomie. Dans les grandes villes comme Londres, Manchester ou Leeds, de nouvelles adresses attirent des ribambelles de clients prêts à débourser plus de 10 £ pour savourer ces créations culinaires.
Des enseignes comme Rogue Sarnies à Londres, Fat Pat’s à Manchester ou Things in Bread à Leeds redéfinissent le concept du sandwich. Ces établissements misent sur des pains artisanaux, des ingrédients locaux de qualité, et des garnitures créatives, inspirées à la fois de traditions britanniques et américaines. Chez Fat Pat’s, par exemple, les sub rolls sont remplis de poulet frit à la Nashville ou de Philly cheesesteaks revisités, tandis que Rogue Sarnies propose des sandwichs cuisinés au feu de bois avec une précision digne de grands restaurants.
Cette transformation du sandwich, longtemps relégué au rang de simple repas à emporter, a pris un tournant décisif avec la pandémie. De nombreux chefs, confrontés à la fermeture de leurs restaurants, se sont tournés vers ce format portable et accessible pour réinventer leur cuisine. Le résultat : des créations riches en saveurs, mêlant textures croustillantes et fondantes, sucré et salé, chaud et froid.
Les réseaux sociaux, en particulier TikTok, ont également joué un rôle crucial dans cette popularité. Les sandwichs colorés et généreusement garnis attirent l’attention des foodies, qui les transforment en véritables phénomènes viraux. Des comptes comme Sensational Sandwiches rassemblent des millions de followers, renforçant l’attrait pour ces délices culinaires.
Malgré leur succès, ces sandwichs haut de gamme suscitent des critiques en raison de leur prix, parfois supérieur à 10 £. Les fondateurs défendent ces tarifs en soulignant la qualité des ingrédients et le travail artisanal derrière chaque préparation. Chez Rogue Sarnies, par exemple, le pain et les garnitures, comme la porchetta ou les légumes grillés, sont réalisés avec autant de soin que les plats d’un menu gastronomique.
L’engouement pour ces sandwichs reflète un changement culturel. Alors que le Royaume-Uni traverse une crise du coût de la vie, ces repas offrent une alternative abordable aux restaurants tout en conservant une touche de luxe. Dans ce contexte, des enseignes comme Sandwich Sandwich à Bristol et Max’s Sandwich Shop à Londres ambitionnent même de rivaliser avec les géants comme Pret A Manger.
Washington Post, How potentially harmful additives have infiltrated America’s food, 22/11/2024
Les additifs chimiques présents dans de nombreux aliments transformés aux États-Unis, conçus pour améliorer saveurs, textures, couleurs et durée de conservation, soulèvent des inquiétudes croissantes quant à leurs impacts sur la santé. Ces substances, souvent approuvées par les fabricants eux-mêmes sans véritable contrôle de la Food and Drug Administration (FDA), se sont infiltrées dans l’alimentation quotidienne grâce à une faille réglementaire majeure.
La réglementation actuelle permet aux entreprises de qualifier un nouvel additif de « généralement reconnu comme sûr » (GRAS) sans consultation préalable de la FDA, un processus initialement conçu pour des ingrédients de base comme le sel ou le vinaigre. Toutefois, cette désignation est désormais exploitée par des entreprises qui déterminent de manière indépendante la sécurité de nouveaux additifs, souvent en s’appuyant sur des experts rémunérés, sans transparence ni rigueur scientifique. Une étude de 2022 révèle que près de 99 % des nouveaux additifs introduits depuis 2000 n’ont pas été approuvés par la FDA.
Cette approche laxiste a conduit à des conséquences graves, comme en témoigne l’affaire de la farine de tara. Utilisée dans un substitut de viande commercialisé par Daily Harvest, cette farine non testée a causé de graves troubles digestifs et des lésions hépatiques chez près de 400 consommateurs, entraînant des hospitalisations et des chirurgies. Ce n’est qu’après cet incident que la FDA a déclaré cette substance « non approuvée » et inadaptée à la consommation humaine.
D’autres additifs jugés GRAS sont également associés à des risques importants. Par exemple, le BHA, un conservateur présent dans de nombreux produits transformés, est classé comme cancérigène probable. Les émulsifiants comme le carboxyméthylcellulose et les polysorbates perturbent le microbiome intestinal, favorisant inflammation et troubles digestifs. Des édulcorants comme l’érythritol sont liés à un risque accru d’accidents cardiovasculaires. Enfin, des conservateurs comme le propyl paraben perturbent les signaux hormonaux, menaçant la fertilité.
Face à ces dangers, certains États et législateurs fédéraux appellent à une réforme. La Californie a récemment interdit quatre additifs, dont le BHA, tandis que l’État de New York envisage une législation similaire. Ces mesures obligeraient les entreprises à fournir des preuves scientifiques de la sécurité des ingrédients qu’elles utilisent, renforçant ainsi la transparence. Au niveau fédéral, le projet de loi Toxic Free Food Act propose de combler la faille GRAS en exigeant une notification préalable et une approbation par la FDA avant l’introduction de tout nouvel additif. Cette loi obligerait également les entreprises à partager leurs données de sécurité avec le public, rétablissant ainsi le rôle de la FDA dans la protection de la santé publique.
Eater, Why Are People So Freaked Out About Seed Oils?, 21/11/2024
Les huiles de graines, longtemps considérées comme des ingrédients anodins dans la cuisine moderne, suscitent une inquiétude croissante. À New York, des affiches accusant le restaurant Carbone d’utiliser des huiles de graines dans son célèbre spicy rigatoni ont relancé un débat déjà virulent sur ces huiles, souvent diabolisées par des influenceurs et des groupes de nutrition en ligne. Mais cette panique est-elle justifiée ?
Les huiles de graines, comme l’huile de tournesol, de maïs ou de canola, sont omniprésentes dans l’industrie alimentaire pour leur faible coût et leur stabilité. Cependant, certains critiques, tels que les utilisateurs de l’application Seed Oil Scout (SOS), les associent à des inflammations chroniques et à des maladies dégénératives. Les critiques se fondent sur la présence d’acides gras oméga-6, qui, en excès, pourraient être pro-inflammatoires. Cette théorie a gagné en popularité grâce à des figures comme le Liver King et des vidéos virales sur YouTube ou TikTok, souvent liées à une vision idéalisée de l’alimentation ancestrale et à des croyances réactionnaires.
Bien que certaines études suggèrent que des concentrations élevées d’acides gras oméga-6 pourraient contribuer à des maladies chroniques, les experts en nutrition appellent à relativiser ces affirmations. Marion Nestle, professeure émérite en nutrition, souligne que les oméga-6 sont essentiels en quantités modérées et que la consommation d’huiles de graines est généralement sans danger lorsqu’elles sont équilibrées avec d’autres sources de graisses. Les vrais problèmes résident dans la surconsommation d’aliments ultra-transformés, souvent riches en sucres, en sodium et en graisses cachées, plutôt que dans les huiles elles-mêmes.
Les restaurants réagissent différemment à cette controverse. Certains, comme Coqodaq à Manhattan, se tournent vers des alternatives comme l’huile Zero Acre, vantée pour ses propriétés stables à haute température et son faible impact environnemental. Shake Shack a également testé cette huile dans ses friteuses, tandis que Sweetgreen a déjà éliminé les huiles de graines de ses préparations. Ces initiatives visent autant à répondre aux préoccupations des consommateurs qu’à surfer sur une tendance culinaire. Le propriétaire de Carbone, de son côté, a riposté aux accusations de SOS en envoyant une lettre de cessation et d’abstention exigeant que SOS retire tous les panneaux incriminant Carbone. SOS maintient toutefois ses affirmations, citant un email de 2023 confirmant l’utilisation d’huile de tournesol dans la recette. Le différend illustre la complexité de ce débat, où la transparence des ingrédients devient un enjeu majeur pour les restaurants.
Forbes, Regenerative Agriculture Is Moving Forward, 22/11/2024
Lors du sommet annuel Sustainable Brands en octobre 2024 à San Diego, un accent particulier a été mis sur l’agriculture régénérative. Ce concept, bien que non standardisé, repose sur des principes communs : traiter les fermes comme des écosystèmes vivants, promouvoir la biodiversité et maintenir la santé des sols. De nombreuses entreprises, telles que PepsiCo, Mars ou encore Maker’s Mark, y ont présenté des initiatives visant à transformer les pratiques agricoles pour un avenir plus résilient.
L’objectif principal de l’agriculture régénérative est d’améliorer la santé des sols. Cela implique des pratiques comme le non-labour, les rotations de cultures diversifiées, l’utilisation de cultures de couverture et l’intégration d’élevages. Ces méthodes favorisent la création d’une matière organique stable, capable de retenir l’eau, les nutriments et de séquestrer le carbone. Par exemple, Mars travaille avec la coopérative Delta Harvest pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la culture du riz, tandis que Mott’s s’efforce d’encourager les pollinisateurs indigènes dans la production de pommes à New York.
Les bénéfices environnementaux de ces pratiques incluent la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à la séquestration du carbone et une meilleure gestion des nutriments, ce qui minimise la pollution des eaux. Des initiatives comme celles de PepsiCo ont déjà montré des résultats positifs : des bénéfices en biodiversité ont été documentés sur 1,6 million d’hectares dans leurs programmes.
Sur le plan économique, l’agriculture régénérative améliore la résilience des sols face aux stress climatiques, stabilisant les rendements et protégeant les revenus agricoles. Cela constitue également un argument pour les entreprises alimentaires qui souhaitent sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement à long terme.
Le succès de cette transition repose sur un soutien adapté aux agriculteurs. Des entreprises comme Mondelez ou PepsiCo collaborent avec des conseillers locaux pour fournir une assistance technique, économique et sociale. Des projets pilotes, comme les essais locaux menés sur 82 fermes par PepsiCo, permettent aux producteurs de constater les résultats dans leur propre contexte.
La vérification des pratiques reste essentielle pour éviter le greenwashing. Des technologies comme l’imagerie satellite et des certifications tierces, telles que le programme Regenified, garantissent l’authenticité des revendications. En 2023, l’initiative Regenerating Together a posé les bases d’un cadre mondial pour l’agriculture régénérative, déjà adopté par des géants comme Nestlé, Danone et Unilever.
Bien que le concept séduise les consommateurs soucieux de l’environnement, l’agriculture régénérative doit dépasser le cadre des produits premium pour avoir un impact significatif. Certaines cultures nécessitant une préservation identitaire, comme les céréales utilisées par Mars ou les pommes de Mott’s, peuvent justifier un prix premium. Cependant, pour les cultures de base comme le maïs ou le soja, l’intégration de pratiques régénératives doit être soutenue par des investissements massifs des industries alimentaires.
Financial Times, Waste less, earn more: a new market for food byproducts, 27/11/2024
Le gaspillage alimentaire reste un défi majeur, avec jusqu’à un cinquième des aliments produits dans le monde jetés chaque année, selon l’ONU. Rien qu’aux États-Unis, Thanksgiving génère 143 millions de kilos de déchets alimentaires, soit une perte estimée à 556 millions de dollars. Ce gaspillage contribue entre 8 % et 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Face à cette réalité, des entreprises explorent des solutions innovantes pour transformer ces pertes en opportunités lucratives.
La technologie offre des pistes intéressantes. L’entreprise irlandaise Senoptica a développé des capteurs intégrés aux emballages de viande pour détecter les fuites d’oxygène, une mesure essentielle pour prolonger la fraîcheur des produits. Ces capteurs permettent de réduire les pertes liées aux dates de péremption arbitraires et de mieux gérer les stocks. Après un lancement prévu ce printemps avec un grand distributeur en ligne, Senoptica vise une expansion dans la distribution traditionnelle.
Parallèlement, l’« upcycling », ou surcyclage, gagne en popularité. Butterfly Equity, un groupe d’investissement, mise sur cette tendance à travers des entreprises comme Actus Nutrition. Cette dernière récupère le lactosérum, un sous-produit de la fabrication de fromage souvent gaspillé, pour le transformer en poudres protéinées et ingrédients nutritionnels. Actus cible des petites et moyennes laiteries qui n’avaient pas les moyens de valoriser ce sous-produit. Ce modèle profite de l’essor du marché des compléments protéinés, en pleine expansion grâce à la popularité des médicaments comme Ozempic, qui augmentent les besoins en protéines.
De même, Chosen Foods, une autre entreprise soutenue par Butterfly, transforme des avocats abîmés ou invendables en huile de cuisson. En plus de générer des revenus pour les agriculteurs, cette approche maximise l’utilisation des ressources comme l’eau nécessaire à la culture des avocats. L’huile d’avocat, prisée pour son goût neutre et son point de fumée élevé, devient une alternative recherchée face aux huiles de graines controversées. La demande est en hausse, soutenue par des campagnes contre les huiles de colza et de tournesol.
Cependant, pour que ces initiatives prospèrent, les entreprises doivent aller au-delà des arguments écologiques. Les consommateurs, particulièrement dans les économies occidentales frappées par l’inflation, privilégient le prix plutôt que l’impact environnemental dans leurs choix alimentaires. Une enquête récente montre que moins de 30 % des consommateurs en Europe et en Amérique du Nord considèrent positivement les produits alimentaires durables.
New York Times, A Chef Who Aims to Educate About How Food Affects the Earth, 26/11/2024
Nadia Sammut, cheffe du restaurant étoilé La Fenière en Provence, utilise sa cuisine pour sensibiliser à l’impact des choix alimentaires sur la santé humaine et la planète. Héritière d’une lignée de restaurateurs, elle a transformé l’établissement familial en un pionnier de la gastronomie sans gluten, reflétant son propre combat contre la maladie cœliaque. Mais au-delà de son restaurant, elle mène un combat plus large à travers son académie Nourrir, dédiée à l’éducation des écoles, agriculteurs, scientifiques et entreprises sur une alimentation durable.
Pour Nadia Sammut, manger est un acte politique. Chaque repas influe sur l’environnement, le climat et les ressources naturelles. Sa mission commence par la revitalisation des sols agricoles grâce à des cultures régénératrices. Elle travaille avec des agriculteurs pour cultiver du pois chiche, un aliment riche en protéines qui nécessite peu d’eau et enrichit les sols en azote. Son objectif est de réintégrer des légumineuses dans les repas principaux pour réduire la consommation excessive de viande, souvent associée à des pratiques agricoles intensives et polluantes.
Elle critique également les pratiques industrielles liées à des produits transformés comme les lasagnes surgelées, dénonçant l’usage de blé transformé, de tomates hors-saison et de conservateurs chimiques. Selon elle, ces aliments participent à un modèle agricole intensif et nocif pour l’environnement et la santé humaine. À La Fenière, sa cuisine s’inscrit en opposition à cette tendance : sans conservateurs ni viande, elle mise sur des recettes végétales qui allient saveur et durabilité. Un exemple phare est son confit de patate douce, cuit lentement dans un four solaire, sans électricité.
Enfin, elle adopte également des solutions innovantes face aux crises écologiques, comme l’intégration du crabe bleu, une espèce invasive méditerranéenne, dans ses plats. Elle espère transformer ce problème en opportunité, démontrant ainsi la nécessité de comprendre les chaînes alimentaires pour mieux les adapter.
New York Times, Taxing Farm Animals’ Farts and Burps? Denmark Gives It a Try, 26/11/2024
Le Danemark, pays connu pour son design innovant et sa gastronomie inventive, fait désormais parler de lui pour une initiative inattendue : une taxe sur les émissions de méthane des animaux d’élevage. Avec cinq fois plus de porcs et de bovins que d’habitants, l’agriculture occupe près des deux tiers des terres et représente une part croissante des émissions de gaz à effet de serre du pays. Face à cette pression, le Parlement danois a adopté une loi pionnière pour taxer les émissions de méthane produites par les excréments, les flatulences et les éructations des animaux.
À partir de 2030, cette taxe imposera aux agriculteurs 300 couronnes danoises (environ 40 €) par tonne équivalente de CO2 émise, un montant qui doublera en 2035. Toutefois, des subventions permettront de réduire ce coût si les agriculteurs adoptent des pratiques plus durables, comme l’utilisation d’additifs alimentaires pour réduire les émissions ou la transformation du fumier en biogaz.
Ce compromis, bien que contesté, a été soutenu par Arla Foods, la plus grande coopérative laitière européenne, et par des agriculteurs tels que Jens Christian Sørensen. Avec près de 300 vaches laitières, ce dernier a déjà investi dans des capteurs pour surveiller la santé et la productivité de son troupeau, et prévoit d’utiliser des additifs chimiques pour réduire le méthane. Selon lui, cette transition est nécessaire pour l’avenir de l’industrie laitière.
Cependant, la taxe ne fait pas l’unanimité. Les militants écologistes la jugent trop clémente, tandis que certains agriculteurs craignent un impact économique. D’autres, comme l’agriculteur bio Svend Brodersen, y voient une opportunité de démontrer que l’agriculture peut être moins polluante. Il a déjà réduit ses terres cultivées pour planter des arbres fruitiers qui absorbent le CO2 et prévoit de consacrer davantage de terres à la production végétale pour l’alimentation humaine.
L’enjeu dépasse les frontières danoises. Le système alimentaire mondial représente un quart des émissions de gaz à effet de serre, et des choix difficiles s’imposent sur les régimes alimentaires et les pratiques agricoles. La consommation de viande et de produits laitiers reste stable en Europe, mais augmente dans les pays en développement. Cette demande croissante pousse le Danemark à repenser son modèle agricole.
En adoptant cette taxe, le Danemark espère inspirer d’autres nations à réduire les émissions agricoles. Comme le souligne Brodersen, « sans taxe, tout le monde continuerait comme avant ». La véritable question reste cependant : combien de terres continueront d’être dédiées aux élevages intensifs ? Pour le Danemark, trouver un équilibre entre production animale et végétale est désormais crucial pour allier rentabilité et durabilité.
New York Times, This Beer Is Made From Sewage. And at the Climate Summit, That’s OK, 22/11/2024
Lors de la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan, une bière singulière a attiré l’attention des participants : la NEWBrew, une pilsner produite à partir d’eau recyclée issue des eaux usées. Offerte gratuitement au pavillon de Singapour, cette initiative surprenante a captivé les visiteurs tout en mettant en lumière une solution innovante face à la rareté croissante de l’eau.
Singapour, dépourvue de ressources naturelles en eau douce, dépend de multiples sources pour répondre à ses besoins : récupération des eaux de pluie, dessalement de l’eau de mer, importations depuis la Malaisie et recyclage des eaux usées grâce à des systèmes de filtration avancés et des traitements par lumière ultraviolette. Ce dernier procédé est au cœur du projet NEWBrew, lancé en collaboration entre la brasserie Brewerkz et l’agence nationale de l’eau de Singapour.
Depuis 2018, cette bière est produite en séries limitées pour des événements et salons, visant à sensibiliser à l’importance du recyclage de l’eau. « C’est un peu un coup de communication, mais ce genre d’initiative fonctionne », a déclaré Ong Tze-Ch’in, directeur général de l’agence nationale de l’eau.
Alors que le réchauffement climatique intensifie les sécheresses et les inondations, environ la moitié de la population mondiale connaît déjà des difficultés d’accès à l’eau potable pendant au moins une partie de l’année, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Cette réalité confère une urgence accrue aux innovations visant à garantir l’accès à une eau propre pour l’alimentation humaine, l’agriculture et les industries.
La NEWBrew a suscité à la fois curiosité et scepticisme parmi les participants de la COP29. Si certains se sont arrêtés au pavillon singapourien pour une dégustation par curiosité, d’autres ont découvert après coup l’origine de cette boisson innovante. Pat Heslop-Harrison, professeur de biologie à l’Université de Leicester, s’est déclaré impressionné par la qualité de l’eau utilisée, affirmant que la technologie singapourienne était « sans égale ».
Pour Samantha Thian, représentante de la délégation jeunesse de Singapour, la bière sert autant à éduquer qu’à initier des discussions. Malgré les réticences initiales, elle constate que beaucoup reviennent pour une seconde dégustation. Certains participants, comme le journaliste Julián Reingold, y voient même un potentiel pour détendre l’atmosphère des négociations climatiques : « Si nous en buvions davantage, qui sait comment cela influencerait les discussions ? »
The Shift Project, Pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère, Novembre 2024
C’est le rapport qui a fait beaucoup parler cette semaine.
Le secteur agricole français est à bout de souffle, aussi bien d’un point de vue physique (aléas climatiques à répétition, détérioration des sols…) qu’économique et social (agriculteurs usés par les difficultés croissantes). Face à ce défi, The Shift Project propose son analyse de la situation, identifie des leviers de transformation, et trace des voies possibles pour concilier réduction de l’empreinte environnementale, résilience des systèmes agricoles et viabilité économique des exploitations.
La transformation ne pourra s’appuyer uniquement sur des leviers d’optimisation, mais devra passer par des évolutions conséquentes des systèmes. Il importe en outre de mobiliser les leviers les plus efficaces et dont les impacts sont les plus sûrs, tout en évitant des choix délétères : décarboner et faire évoluer les pratiques de fertilisation, réduire les émissions et accroître la résilience des systèmes d’élevage, réduire la demande énergétique et décarboner l’énergie utilisée, préserver la biodiversité, augmenter le stockage de carbone par l’agriculture, assurer la circularité des systèmes agricoles et le rebouclage des cycles biogéochimiques, et repenser les flux logistiques pour plus de résilience.
Ce projet a imaginé des projections possibles de transformation du système agricole en explorant la priorisation 1/ d’une meilleure autonomie agricole et alimentaire nationale, 2/ d’une moindre dépendance énergétique nationale, et 3/ du maintien de capacités exportatrices. Cet exercice a mis en évidence un besoin de pragmatisme et de compromis, d’où la construction d’un 4ème scénario dit “de conciliation”, fondé sur le respect d’objectifs climatiques et énergétiques, et surtout de résilience, proposant un arbitrage possible entre les différentes priorités stratégiques.
Ce scénario, s’il n’épuise pas la réflexion, montre surtout qu’il est urgent de faire un choix de société dès aujourd’hui et décider quelle agriculture nous souhaitons en 2050, pour initier les changements dès maintenant, permettre aux parties prenantes d’inscrire leurs choix dans une trajectoire fiable, et accompagner les acteurs qui auront le plus d’efforts à fournir.
Parmi les recommandations :
1- Clarifier le cap et accompagner les acteurs
2- Garantir la sécurité économique des agriculteurs
3- Anticiper les besoins en compétences, recherche et connaissances
4- Mobiliser les acteurs territoriaux (filières, collectivités)
5- Pour les agriculteurs, s’engager en agroécologie
Un post qui fait réagir sur LinkedIn et qui concerne la ré appropriation culturelle de certains plats étrangers. Ici le cas d’un mafé
C’est tout pour aujourd’hui.
Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.
Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)
A la semaine prochaine!
O. Frey